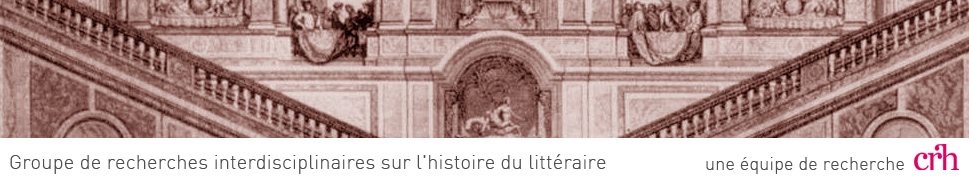Enseignement |
Séminaire de Dinah Ribard
2004-2005 : Savoirs, métiers, gestes
Le travail intellectuel : histoire (1600-1900)
2e et 4e mardis du mois de 11h à 13h (salle 5, 105 Bd Raspail)
Résumé
Le séminaire s'est structuré, cette année, autour de deux objets principaux. La question des pathologies intellectuelles, d'abord, c'est-à-dire les écrits, dont beaucoup de livres, sur les maladies des intellectuels écrits par des médecins entre xviiie et premier xixe siècle. On s'est efforcé de les interroger non comme une production nouvelle révélatrice d'une progressive professionnalisation des activités intellectuelles, mais du point de vue des opérations, des gestes intellectuels réalisés par les auteurs de ces livres. Ces médecins - plusieurs cas ont été étudiés, de celui, célèbre, de l'auteur de l'essai De la santé des gens de lettres et de l' Avis au peuple sur sa santé, Tissot, à ceux de ses successeurs revendiqués Brunaud et Réveillé-Parise, à celui de Fourcroy traducteur de Ramazzini et à d'autres moins connus comme Hecquet ou Saucerotte - ont pour point commun d'élaborer, dans et par ces livres, un rapport spécifique à leur profession. Les livres sur les pathologies intellectuelles s'insèrent en effet - y compris dans la carrière de leurs auteurs, qui ont le plus souvent produit à la fois des ouvrages adressés aux intellectuels et des ouvrages de médecine « charitables » destinés aux divers praticiens de la santé populaire (médecins de campagne plus ou moins qualifiés, dames charitables, curés ou pasteurs, mais aussi employeurs) - dans tout un ensemble d'écrits dont la visée peut être qualifiée de législatrice : il s'agit pour ces médecins, et c'est là leur travail intellectuel spécifique, de se poser en quelque sorte en régulateurs des rapports de la société à la médecine. La réflexion sur la désinstitutionnalisation des pratiques ou par les pratiques entamée l'an dernier (en l'occurrence les pratiques d'écriture sur des sujets médicaux qui se définissent comme destinées à agir hors de l'univers professionnel des médecins) a pu ainsi être poursuivie, entre fin xvie - début xviie siècle, époque des premiers livres de médecine « charitable », et milieu du xixe siècle, où les productions du journaliste médical qu'était Réveillé-Parise ont été observées de près. Chemin faisant, on s'est efforcé de relire dans cette perspective les pages consacrées par Michel Foucault, dans Naissance de la clinique, à Fourcroy et aux acteurs de la réorganisation révolutionnaire de l'enseignement médical.
Le deuxième objet mis en chantier cette année donnait lui aussi à voir un travail intellectuel sur des métiers artisanaux (cordonnier et tailleur) ; mais ce travail portait cette fois sur les conditions d'exercice de ces métiers. Il s'agissait de communautés dont l'existence est attestée jusqu'à la Révolution, fondées au milieu du xviie siècle (1645 et 1647) dans le but de réunir des artisans pour travailler et vivre ensemble dans un esprit de perfection chrétienne. Quasi-religieuses (mais seulement quasi : les frères cordonniers et tailleurs ne furent jamais un ordre religieux), ces communautés rassemblant des compagnons tailleurs et des compagnons cordonniers permettaient à ceux-ci de modifier profondément leurs conditions de travail, puisque l'application du modèle monastique conduisait à l'élection du maître, à l'imitation des abbés. Les statuts successifs des frères, dont il existe différentes versions manuscrites et imprimées, ont été étudiés, ainsi que les conflits et procès dans lesquels ils se sont trouvés engagés, les politiques de leurs protecteurs (dévots proches de la Compagnie du Saint-Sacrement au départ, curés et parlementaires liés aux milieux jansénistes étudiés par Catherine Maire par la suite) et enfin leur rôle crucial dans la répression, et par là la production de sources sur le compagnonnage. Cet objet permettait d'observer la spiritualisation du travail manuel et des métiers mécaniques comme travail intellectuel, de poser la question des conditions sociopolitiques de possibilité d'un tel travail intellectuel, et de réfléchir sur l'acquisition et l'accumulation de savoirs (notamment scripturaires et juridiques) qu'une telle organisation a pu rendre possible. L'enjeu était aussi de croiser deux historiographies qui se croisent peu souvent : l'histoire religieuse et l'histoire du travail.
Quelques séances ont été consacrées à la poursuite du travail sur le poète-menusier Adam Billaut (avec une réflexion sur la rencontre entre sa trajectoire sociale et celle de son protecteur Michel de Marolles) et à la « collection Lamoignon », recueils manuscrits rassemblant des copies d'actes divers qui concernent en particulier la police du travail à Paris, constitués au xviiie siècle et conservés aux archives de la préfecture de police. Enfin, deux invités sont venus parler du rapport au travail de magistrats du xviie siècle à travers la question de leur emploi du temps (C. Blanquie, CRH), et de la manière dont la difficulté de l'érudit Casaubon à penser le caractère professionnel de son activité intellectuelle le conduit, en particulier dans son journal, à retravailler les catégories comme celle « d'étude » ou « d'encyclopédie » (H. Parenty, Lyon).
Publications
« L'utopie physique de Cyrano de Bergerac », dans Lectures de Cyrano de Bergerac Les États et Empires de la Lune et du Soleil, dir. B. Parmentier, Presses Universitaires de Rennes, 2004, p. 37-48.
« Histoire littéraire et histoire : le parallèle Corneille-Descartes (1765-1948) », Dix-septième siècle, n° 225, 2004-4, « Corneille après Corneille, 1684-1791 », dir. M. Dufour-Maître, p. 577-583.
« Sottise et inadaptation : le philosophe dans le monde » dans Sottise et ineptie, de la Renaissance aux Lumières. Discours du savoir et représentations romanesques, études réunies par N. Jacques-Lefèvre et A.-P. Pouey-Mounou, Nanterre, Littérales n° 34 / 35, 2004, p. 95-106.
« Racine historiographe et le genre de la Vie » dans Racine et l'Histoire, textes réunis et publiés par M-C Canova-Green et A. Viala, Biblio 17 n° 155, Tübingen, Gunter Narr, 2004, p. 207-223.
« L'écriture historienne de Pierre Michon : la parole et la vision » dans Ch. Jouhaud (dir.), « Pierre Michon, historien », Critique, 694, mars 2005, p. 187-195.
« Politique de la littérature : les romans à clef du xviie siècle selon Victor Cousin », Littératures classiques, 54, n° spécial Lectures à clés, dir. M. Bombart et M. Escola, 2005, p. 257-268.
 Les Actualités
Les Actualités
Archiver les cultures populaires
 Journée(s) d'étude - Mercredi 14 décembre 2022 - 09:00PrésentationJournée d’études organisée par Constance Barbaresco (EHESS/CRH) et Samia Myers (Université de Strasbourg), soutenue par le Centre (...)
Journée(s) d'étude - Mercredi 14 décembre 2022 - 09:00PrésentationJournée d’études organisée par Constance Barbaresco (EHESS/CRH) et Samia Myers (Université de Strasbourg), soutenue par le Centre (...)
1848 et la littérature
 Journée(s) d'étude - Jeudi 16 janvier 2020 - 09:00Les révolutions de 1848 ont été perçues par leurs contemporains comme des révolutions littéraires dans plus d'un sens : précipités par la littérat (...)
Journée(s) d'étude - Jeudi 16 janvier 2020 - 09:00Les révolutions de 1848 ont été perçues par leurs contemporains comme des révolutions littéraires dans plus d'un sens : précipités par la littérat (...)
Le particulier, le singulier, l’universel. Charles Sorel (1602-1674)
 Journée(s) d'étude - Mercredi 18 décembre 2019 - 09:00Ces travaux féconds et novateurs permettent de prendre la mesure d’une œuvre dont la force et la cohérence ont été incomprises ou sous évaluée (...)
Journée(s) d'étude - Mercredi 18 décembre 2019 - 09:00Ces travaux féconds et novateurs permettent de prendre la mesure d’une œuvre dont la force et la cohérence ont été incomprises ou sous évaluée (...)
GRIHL
Centre de recherches historiques
EHESS
54 Boulevard Raspail
75006 Paris
E-mail : grihl@ehess.fr