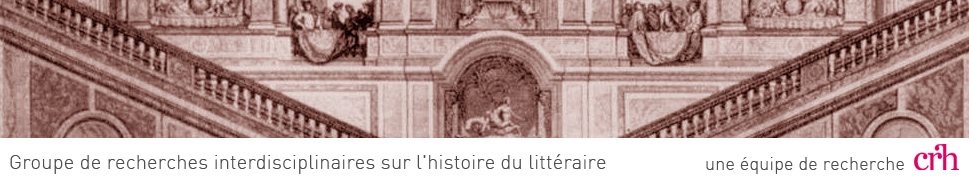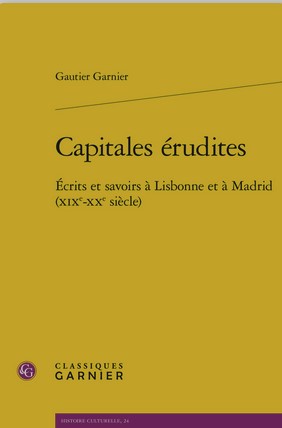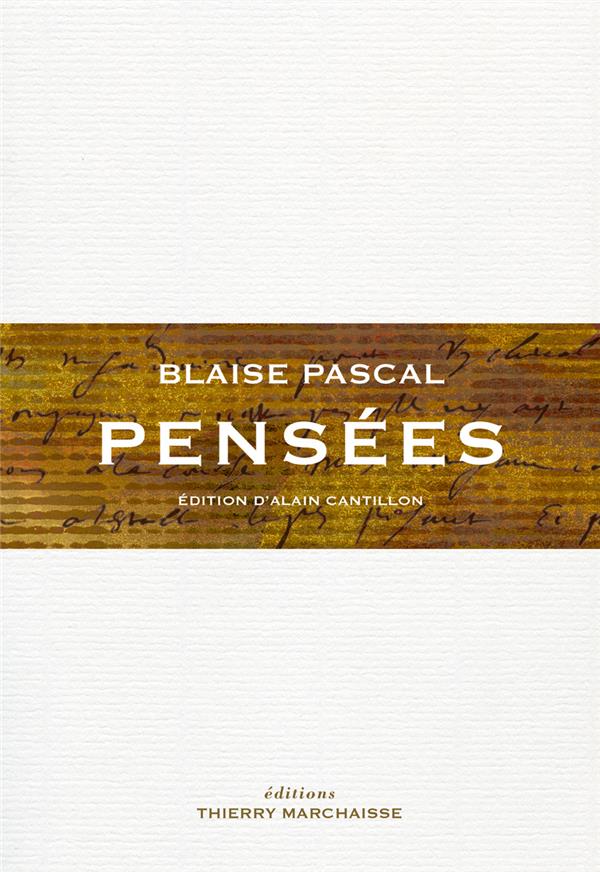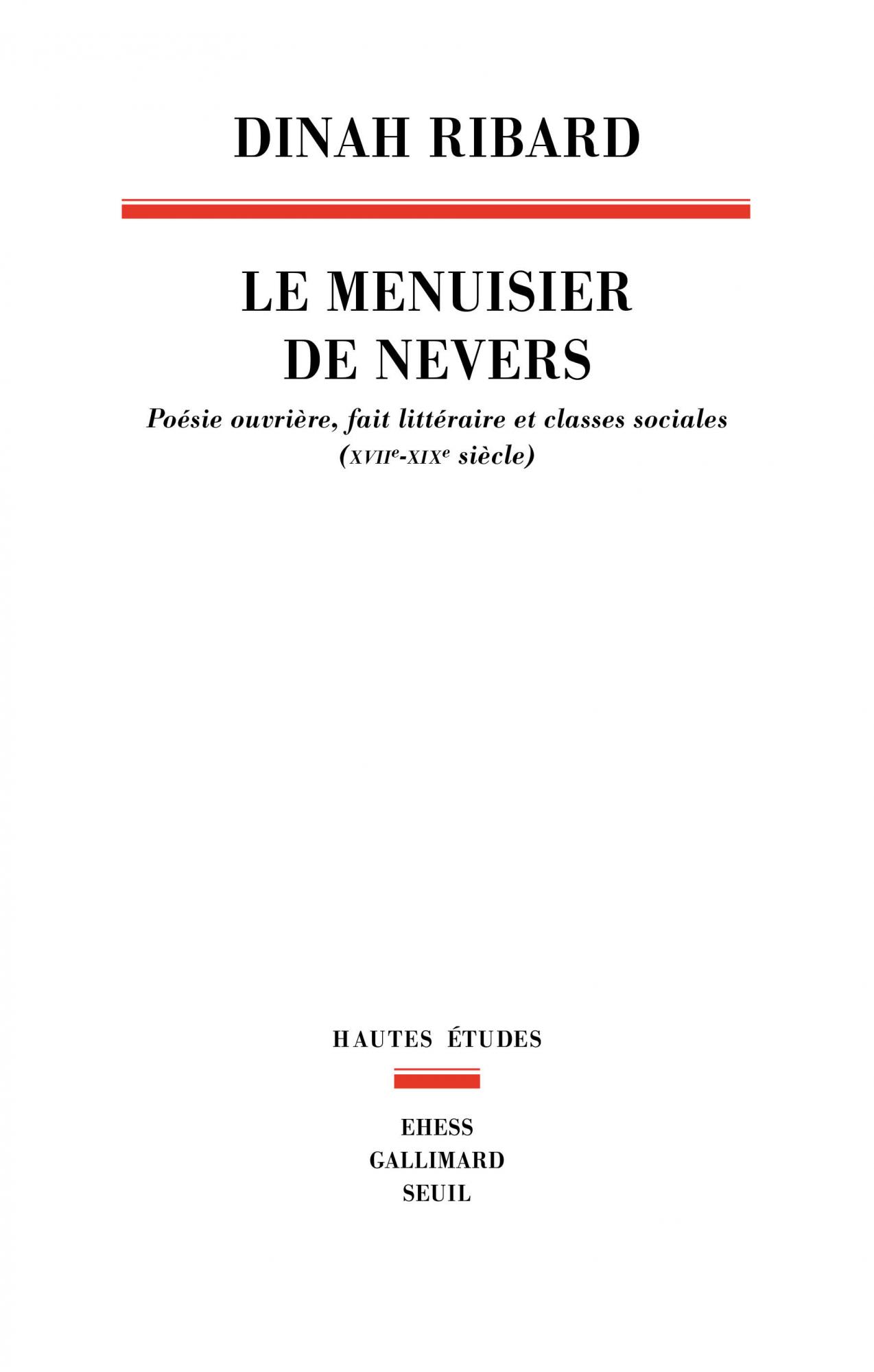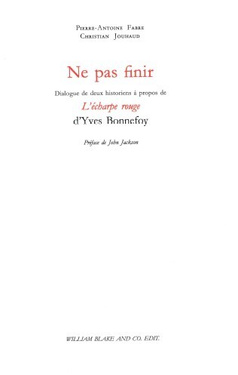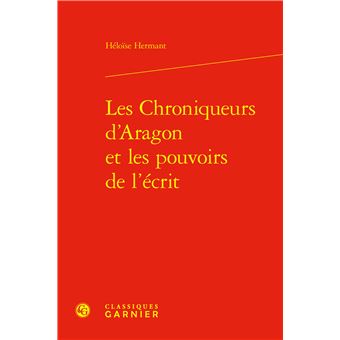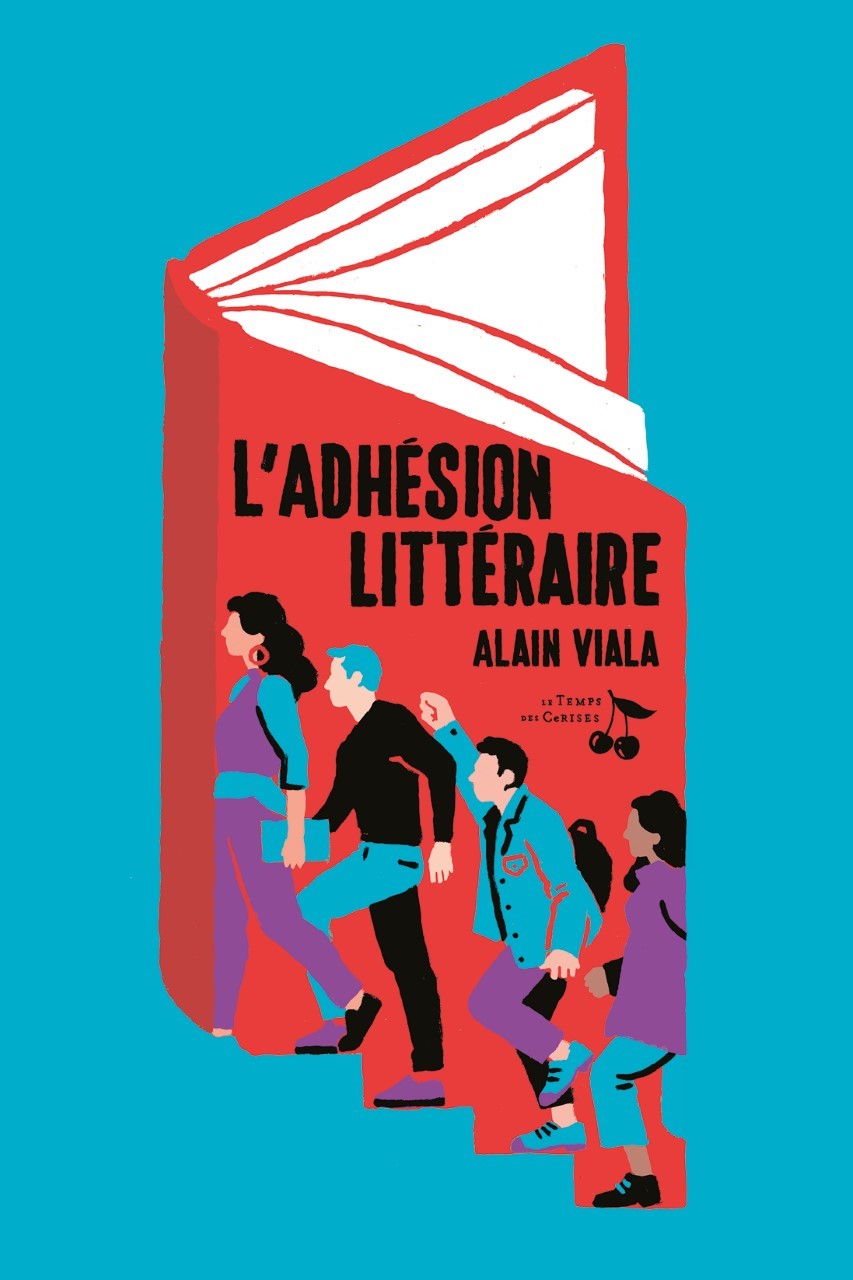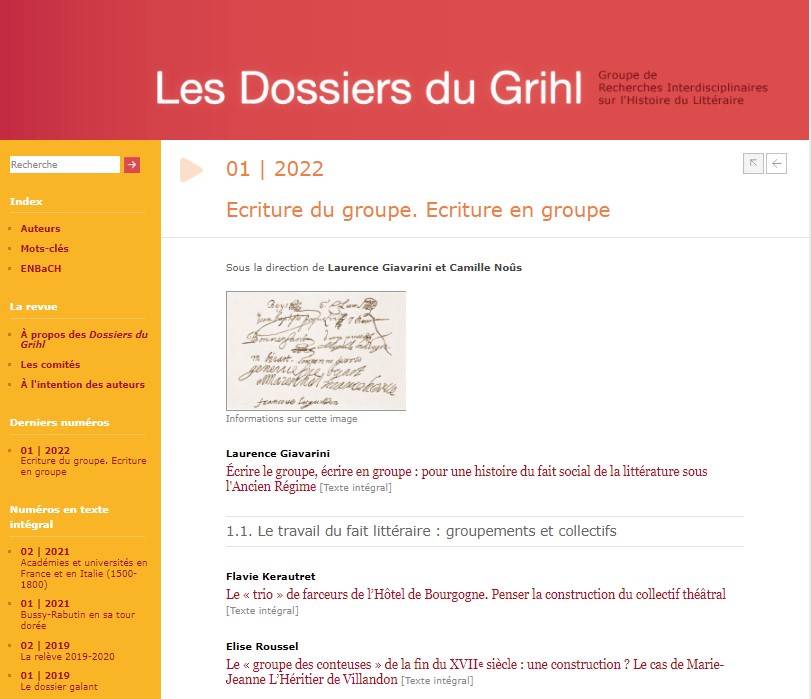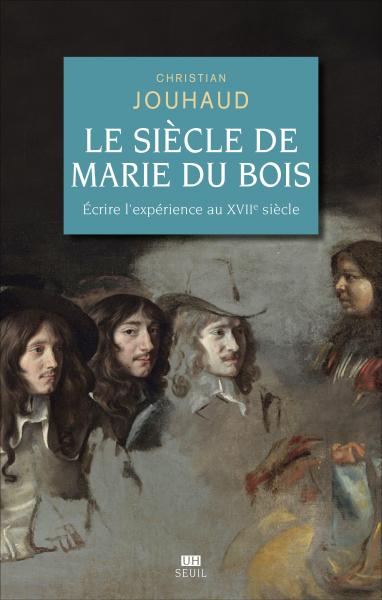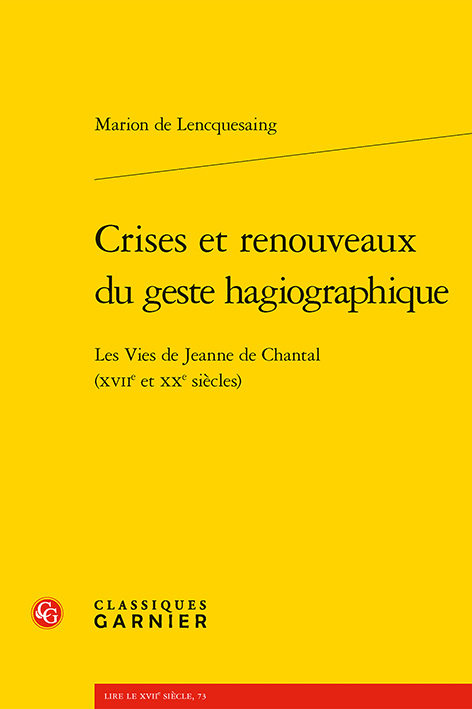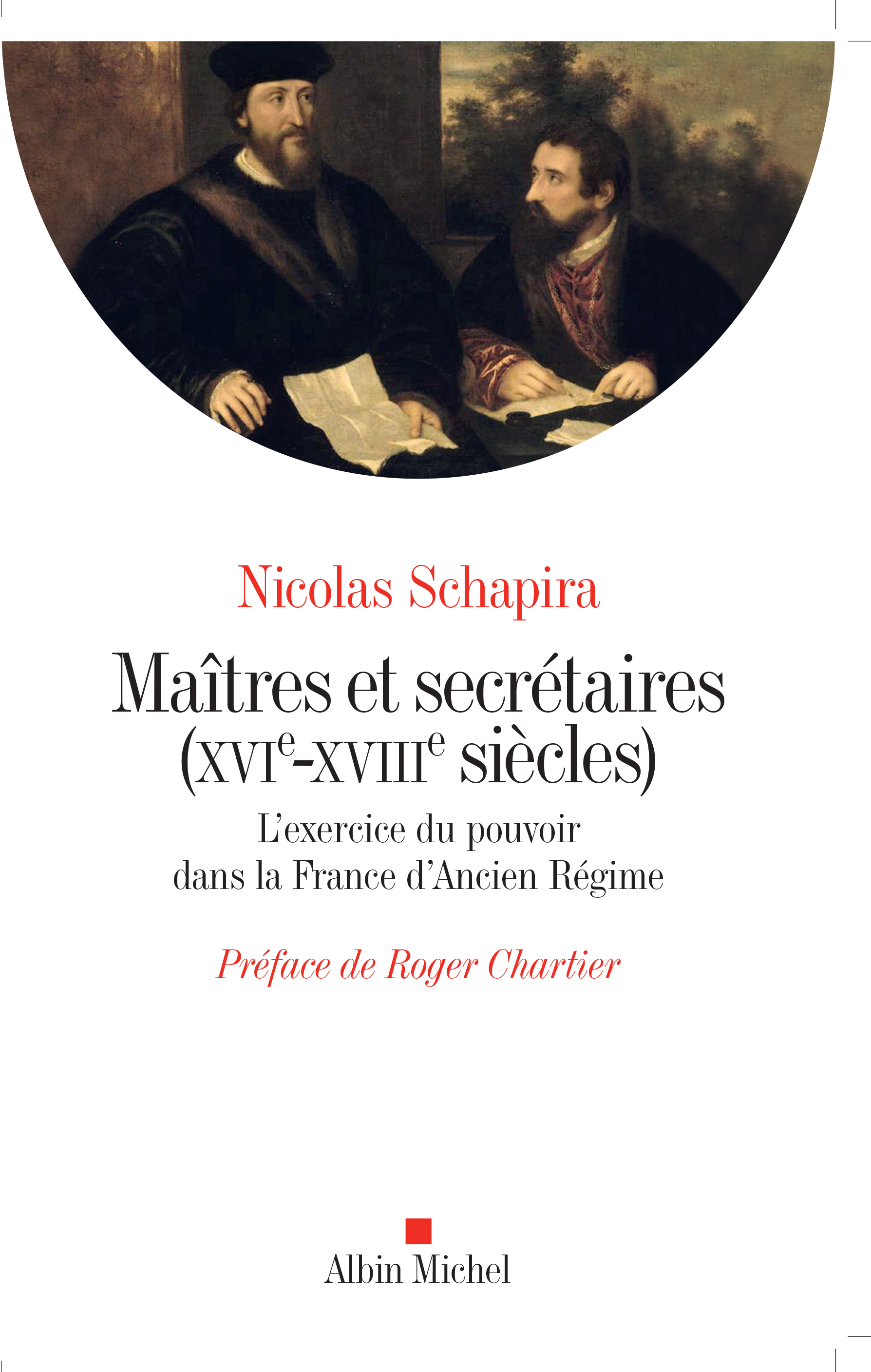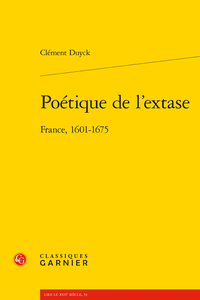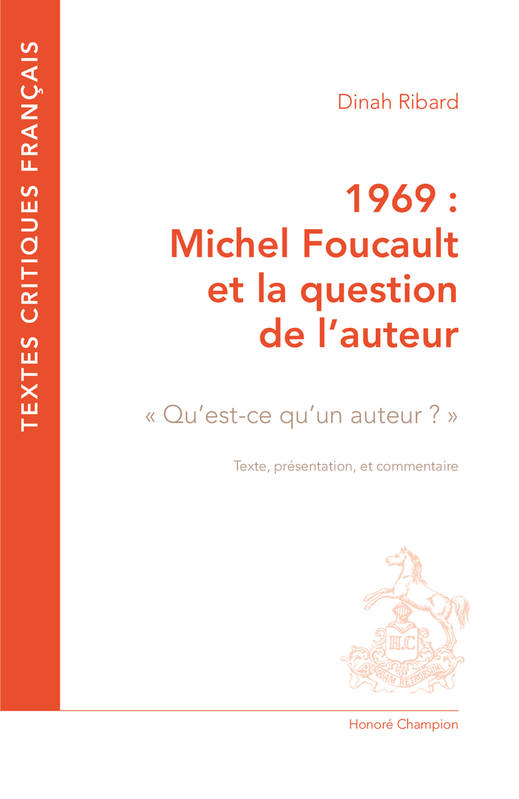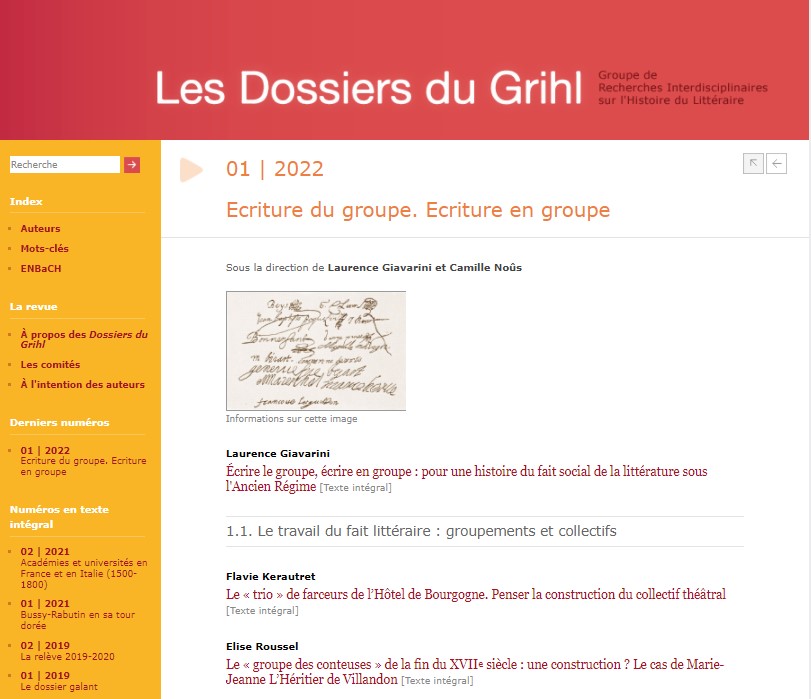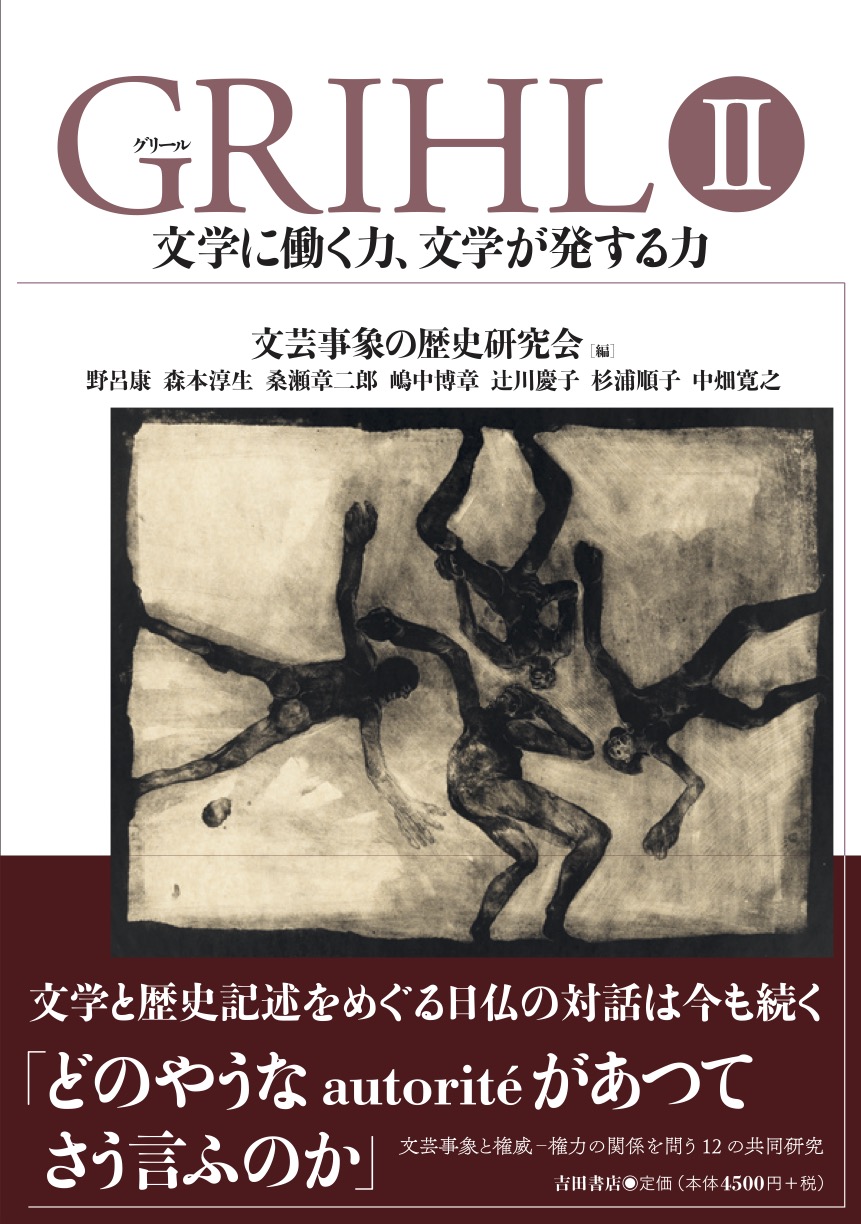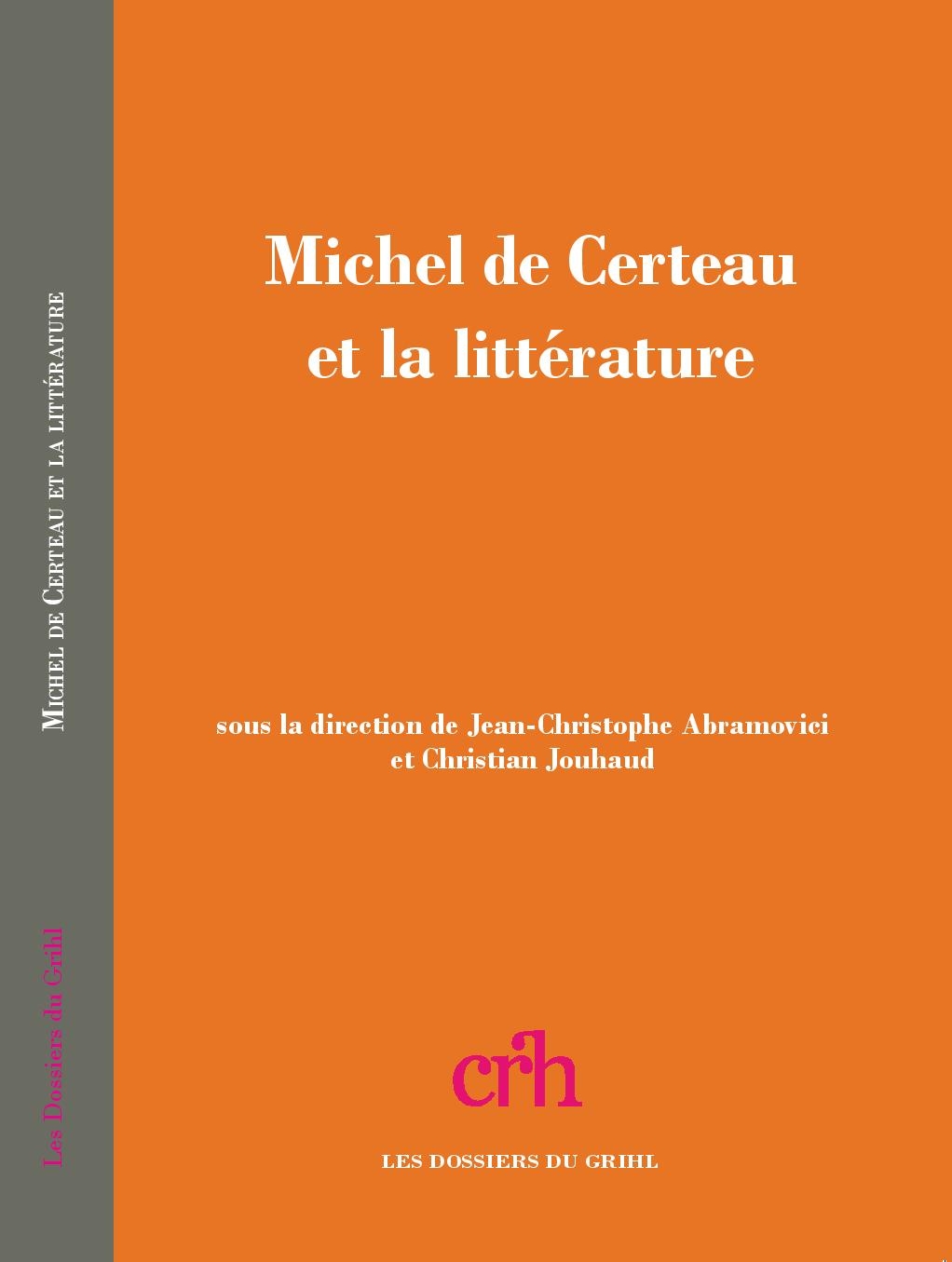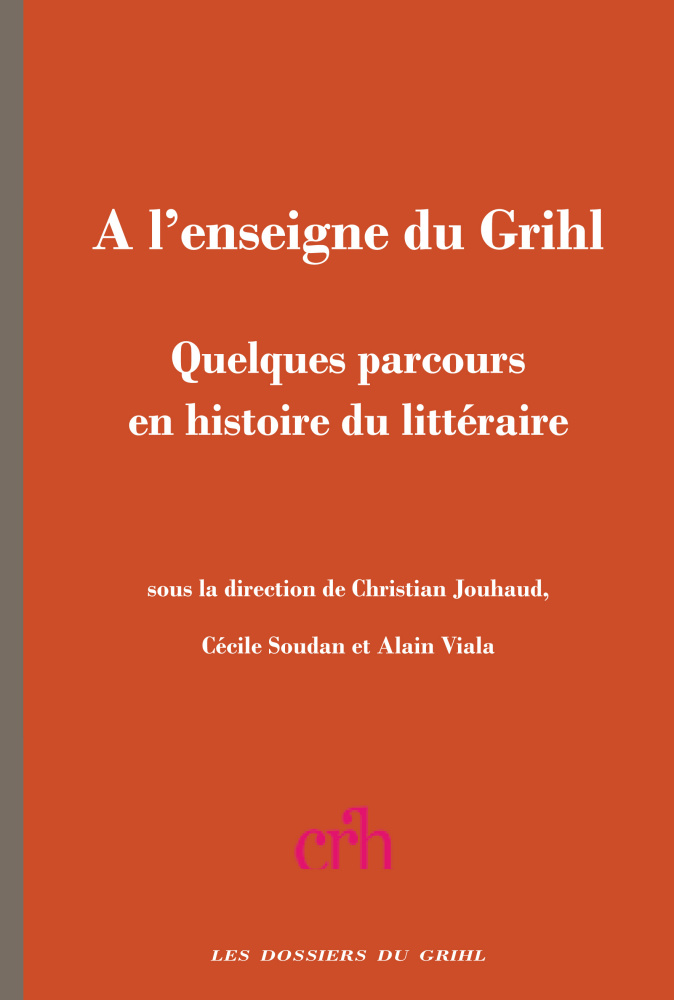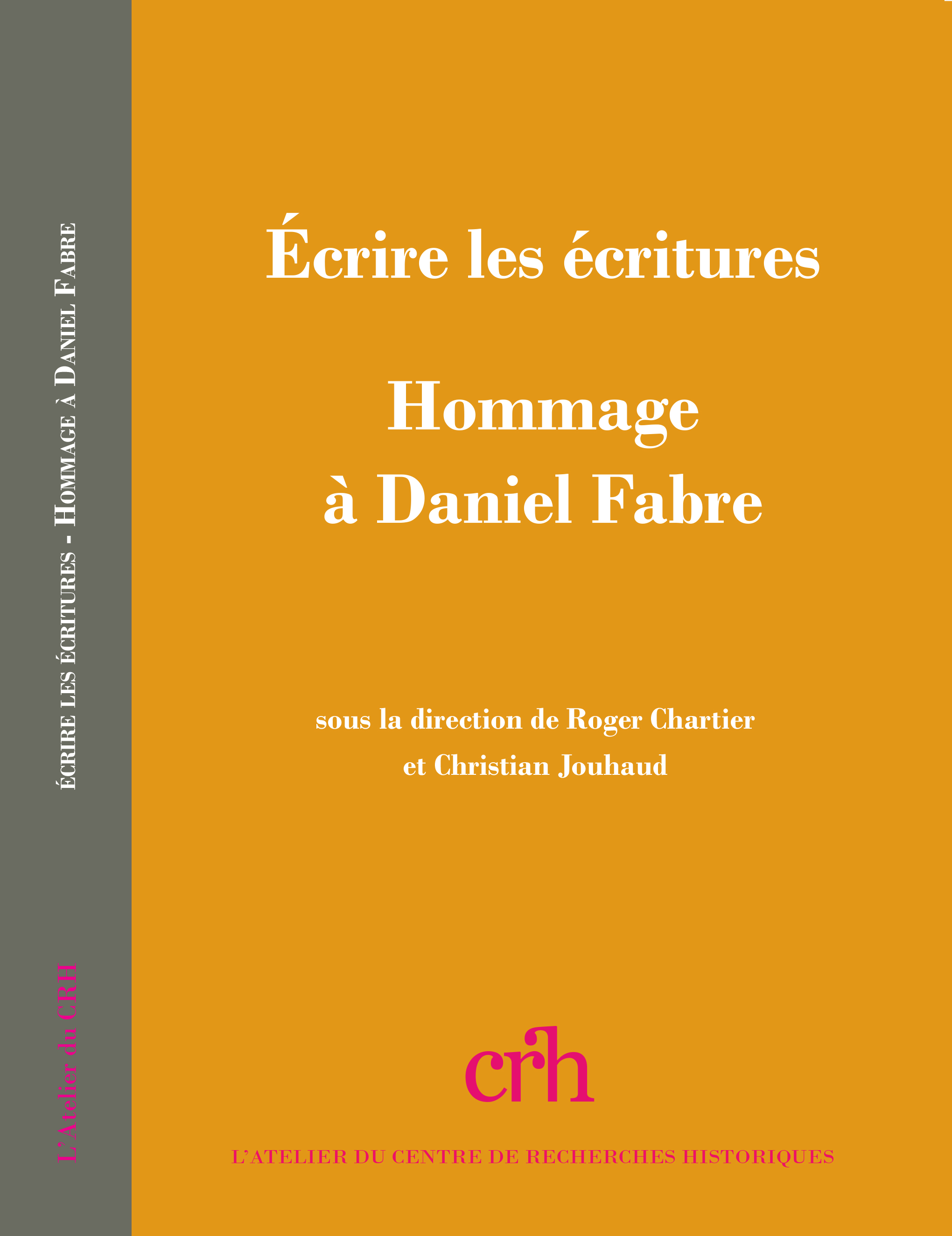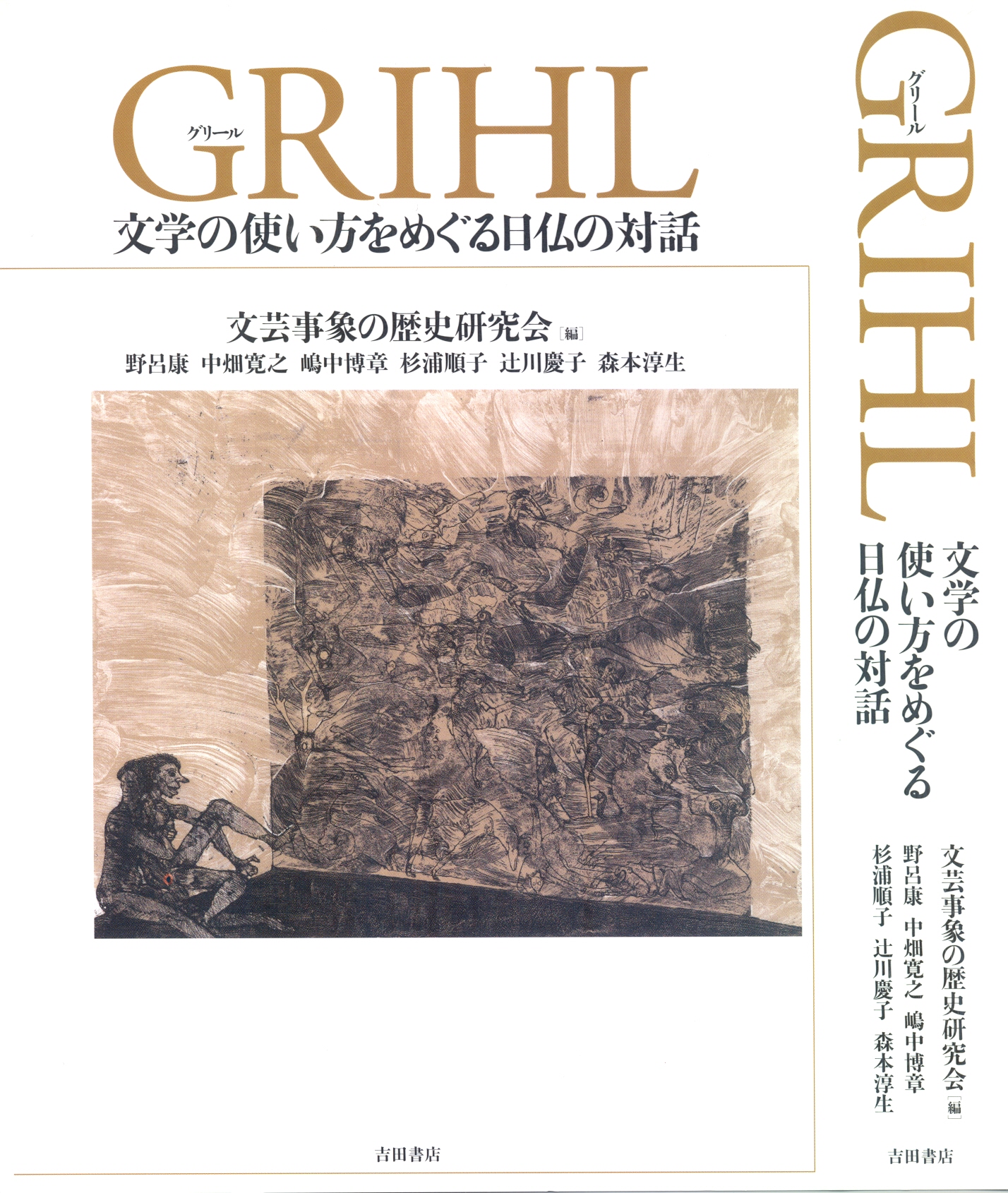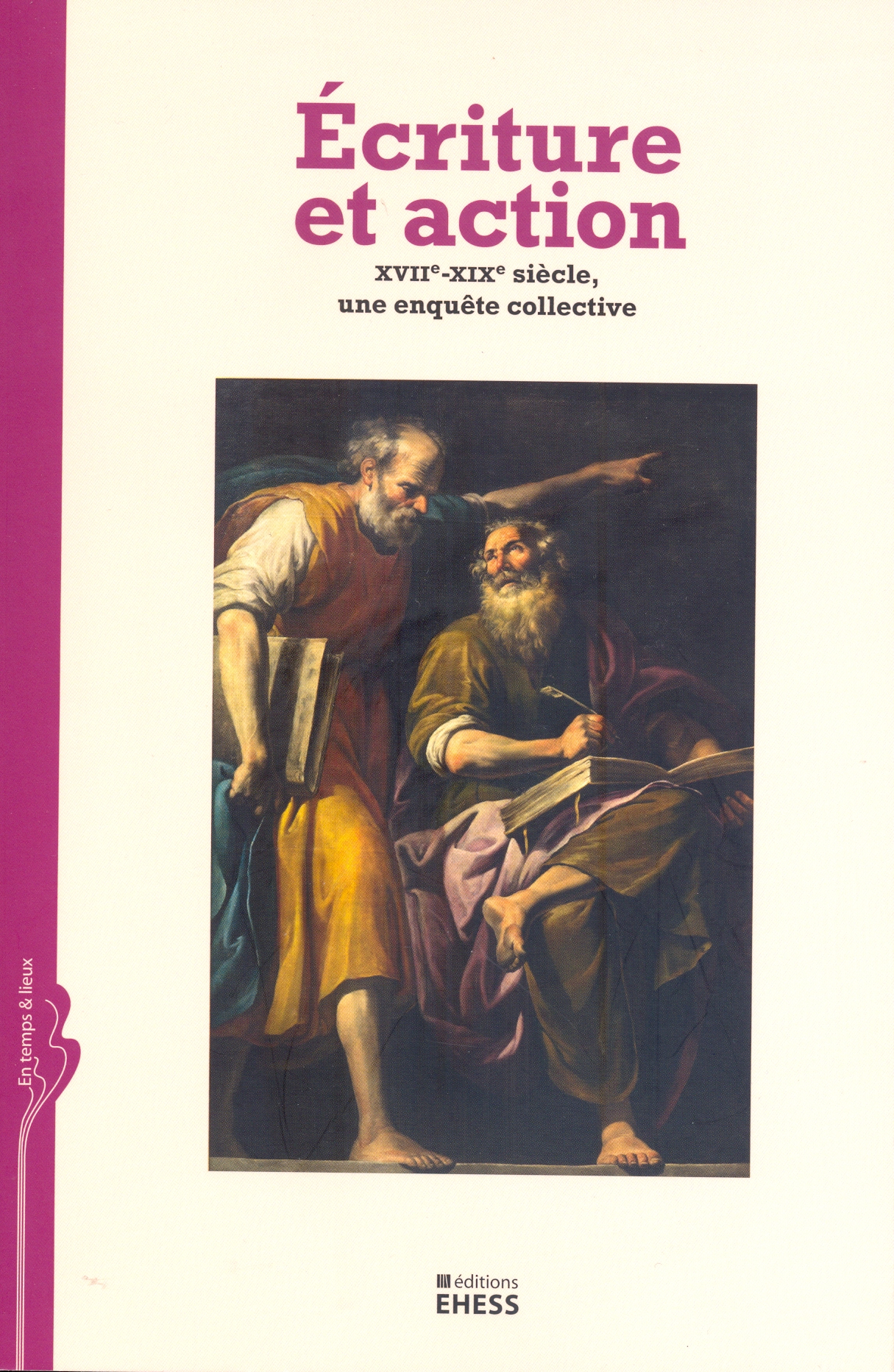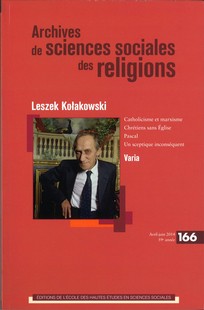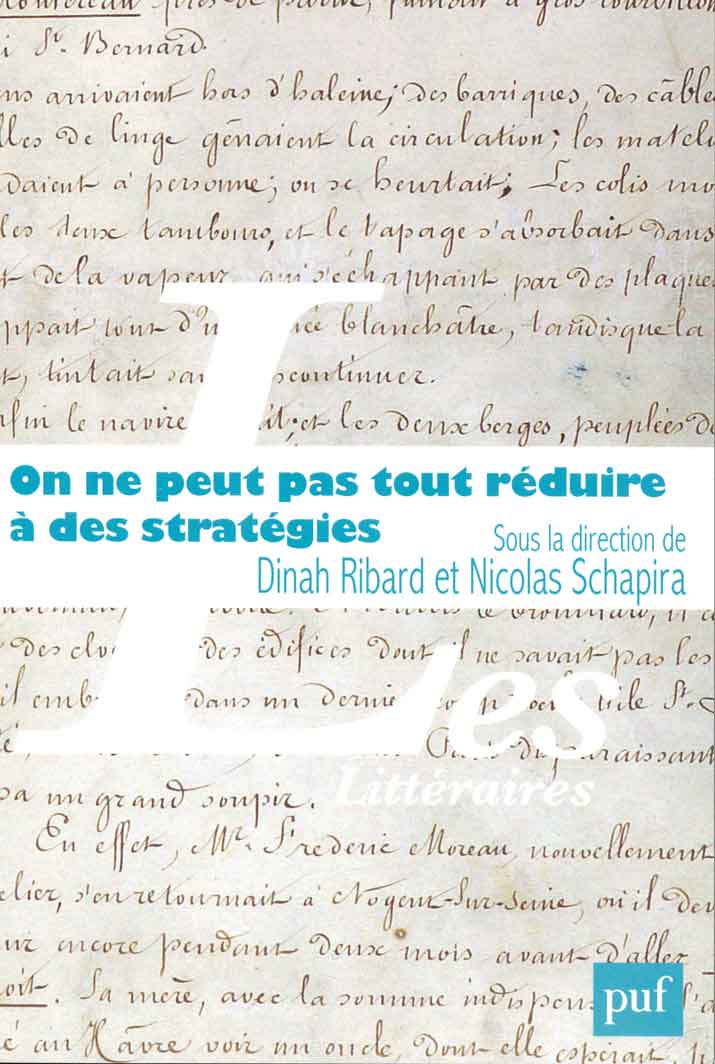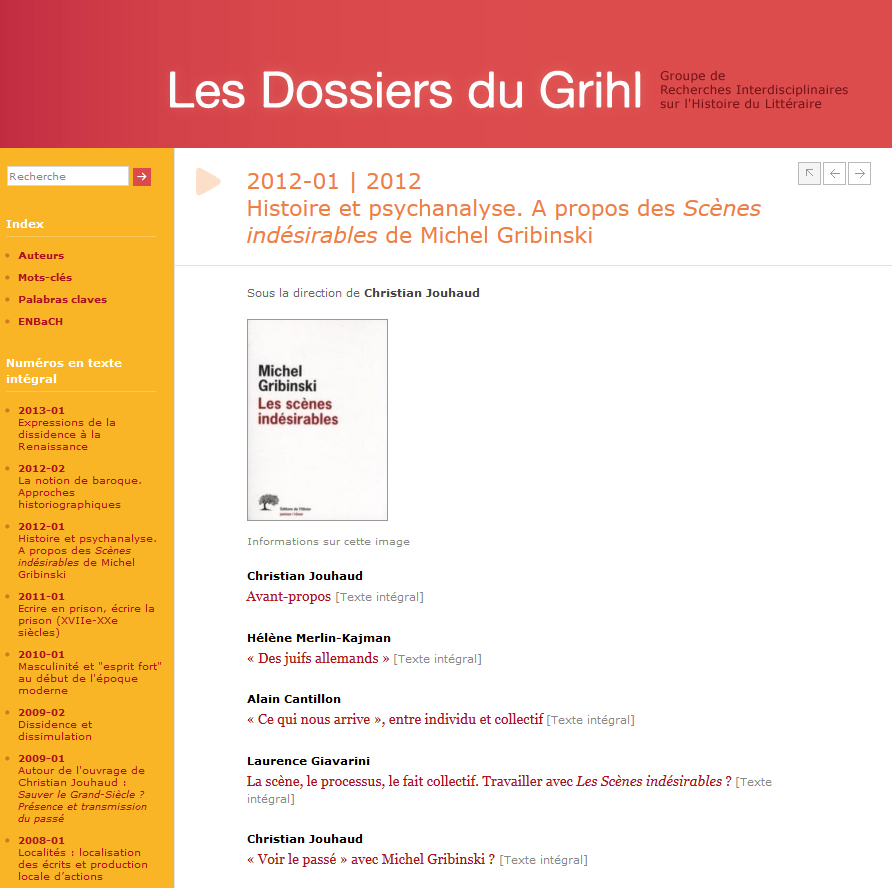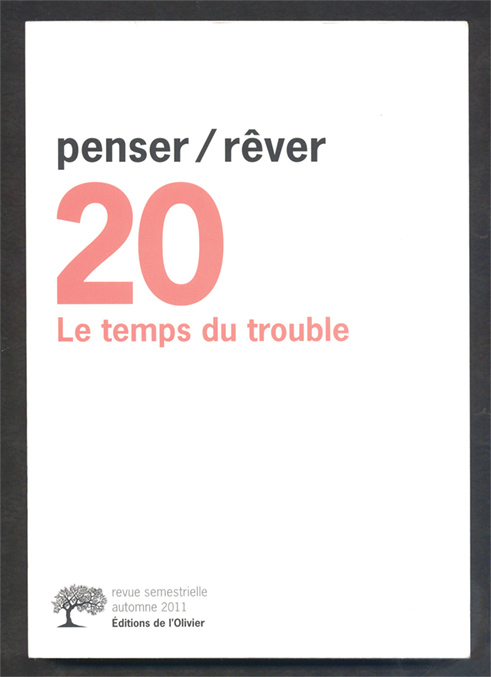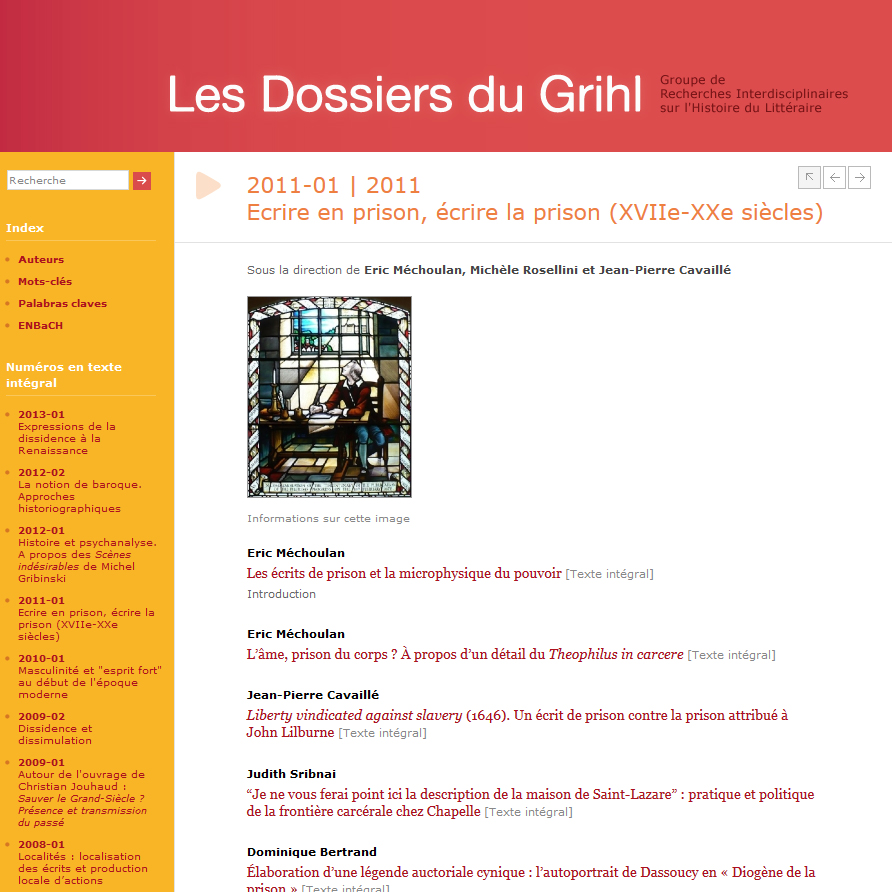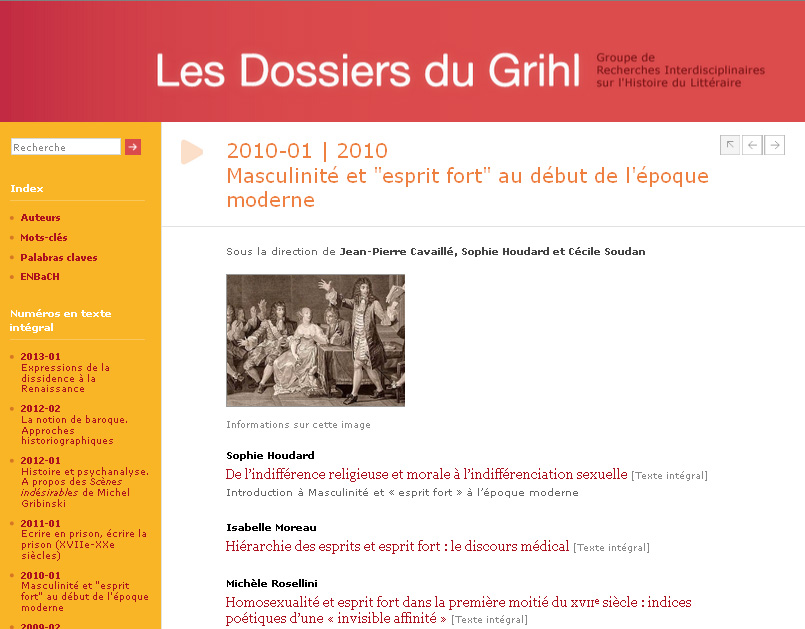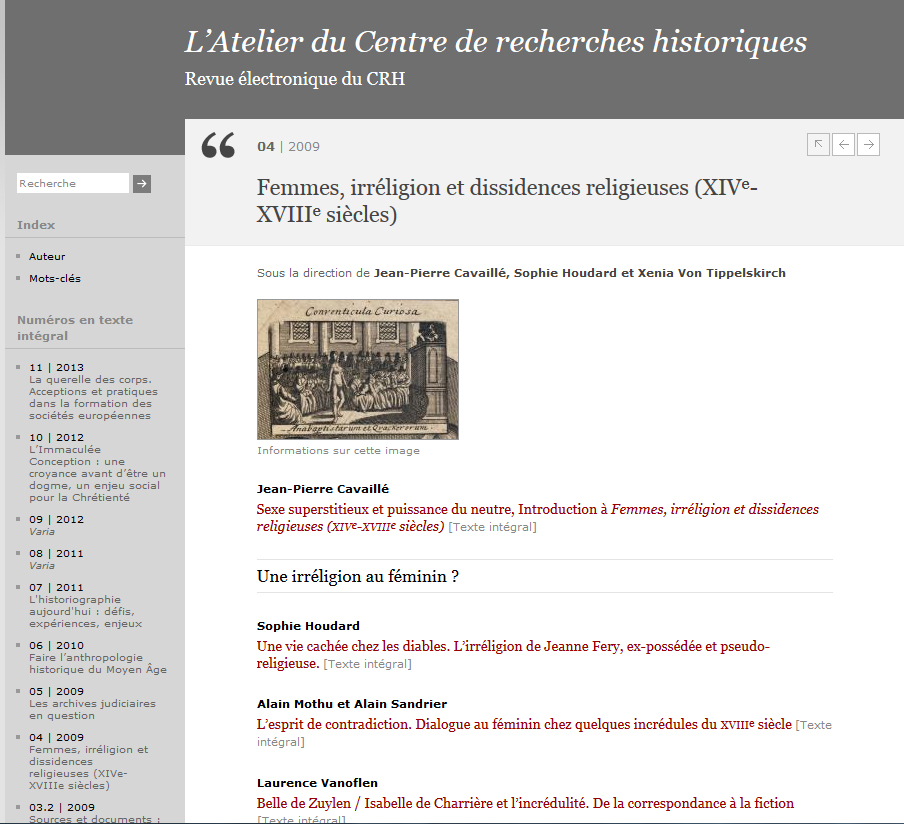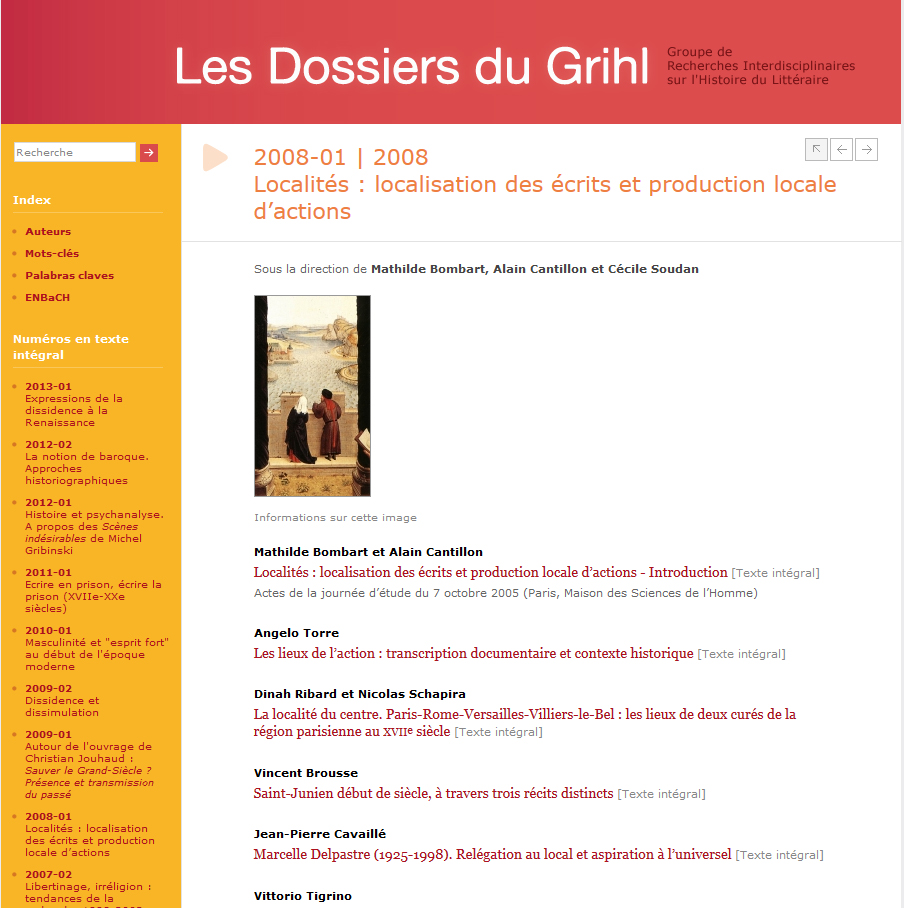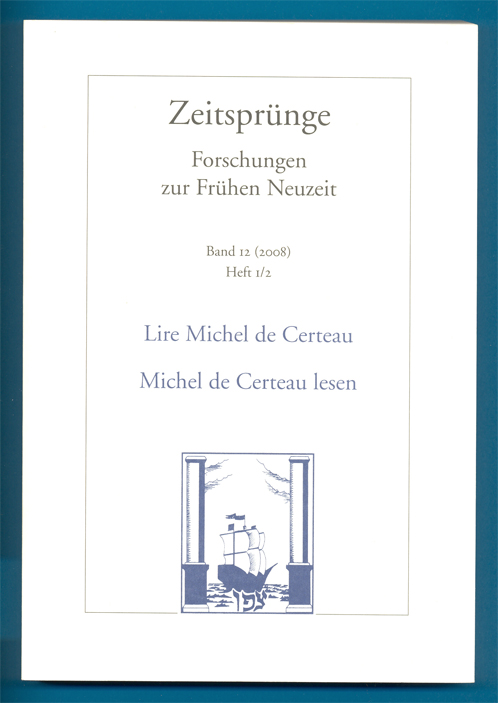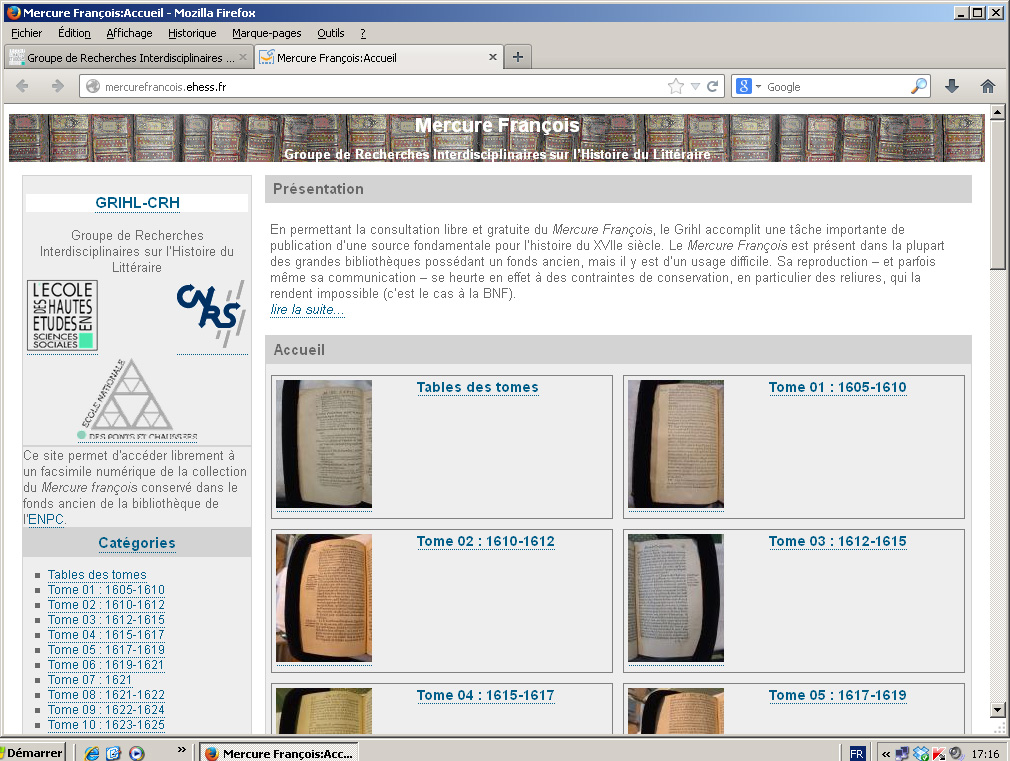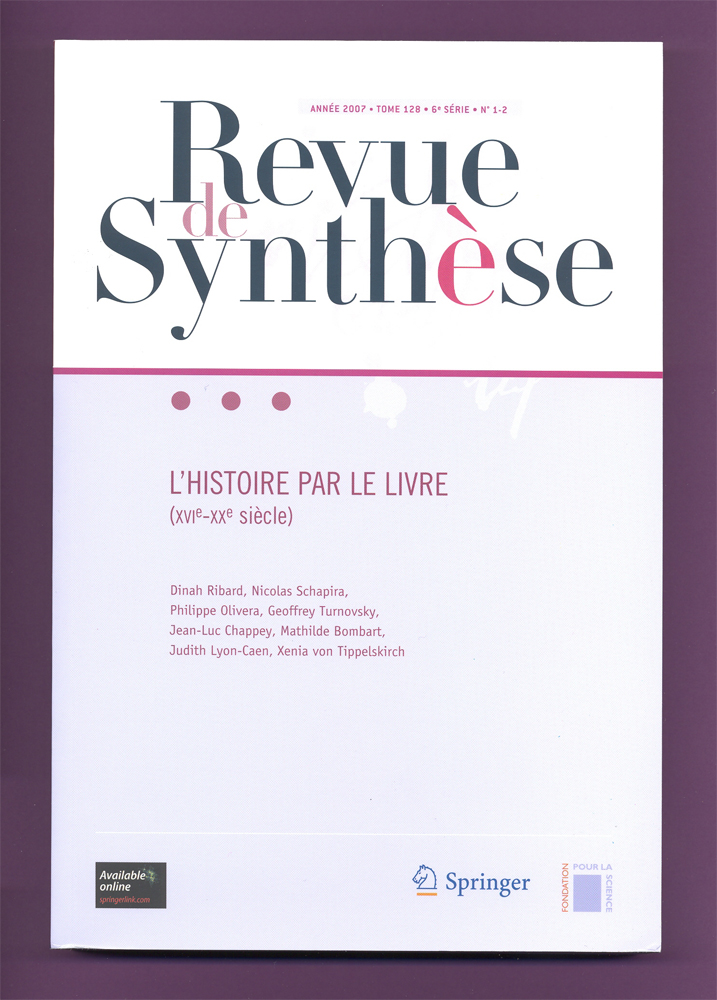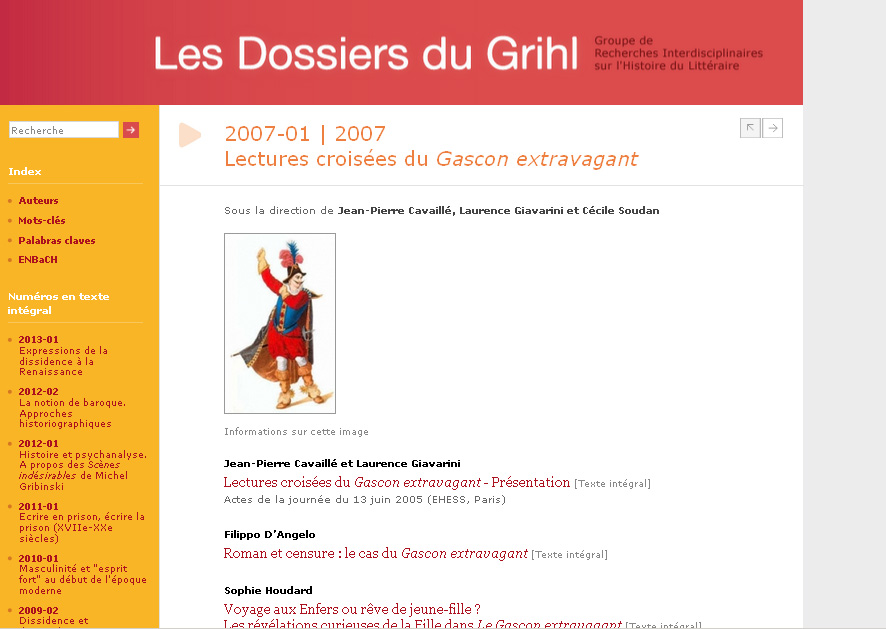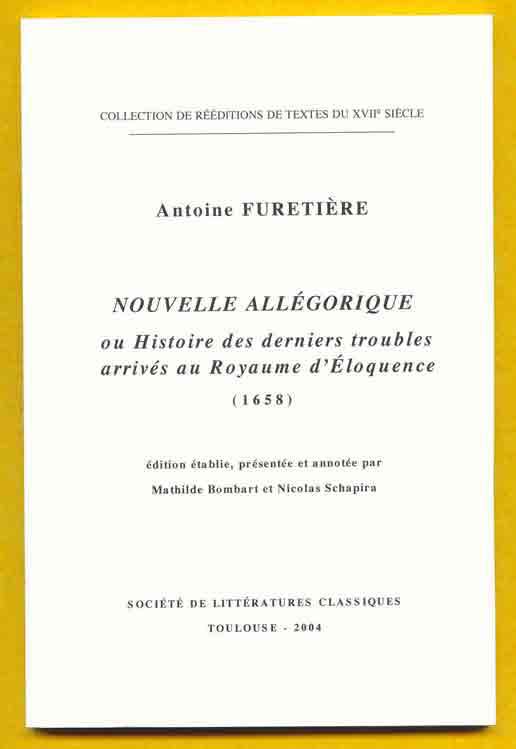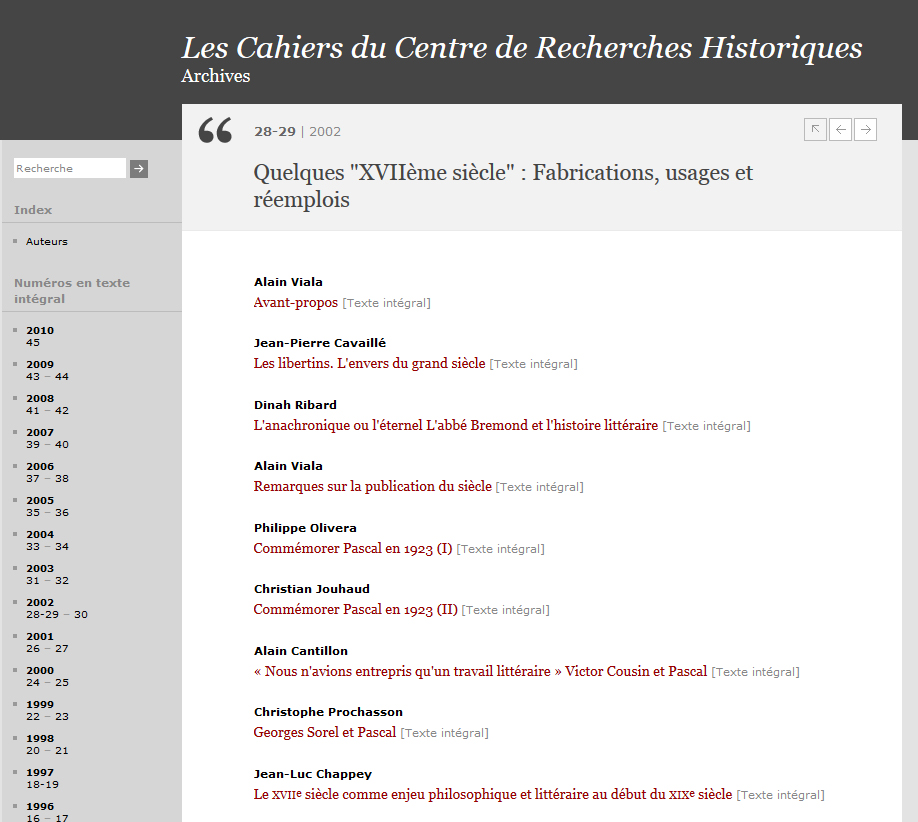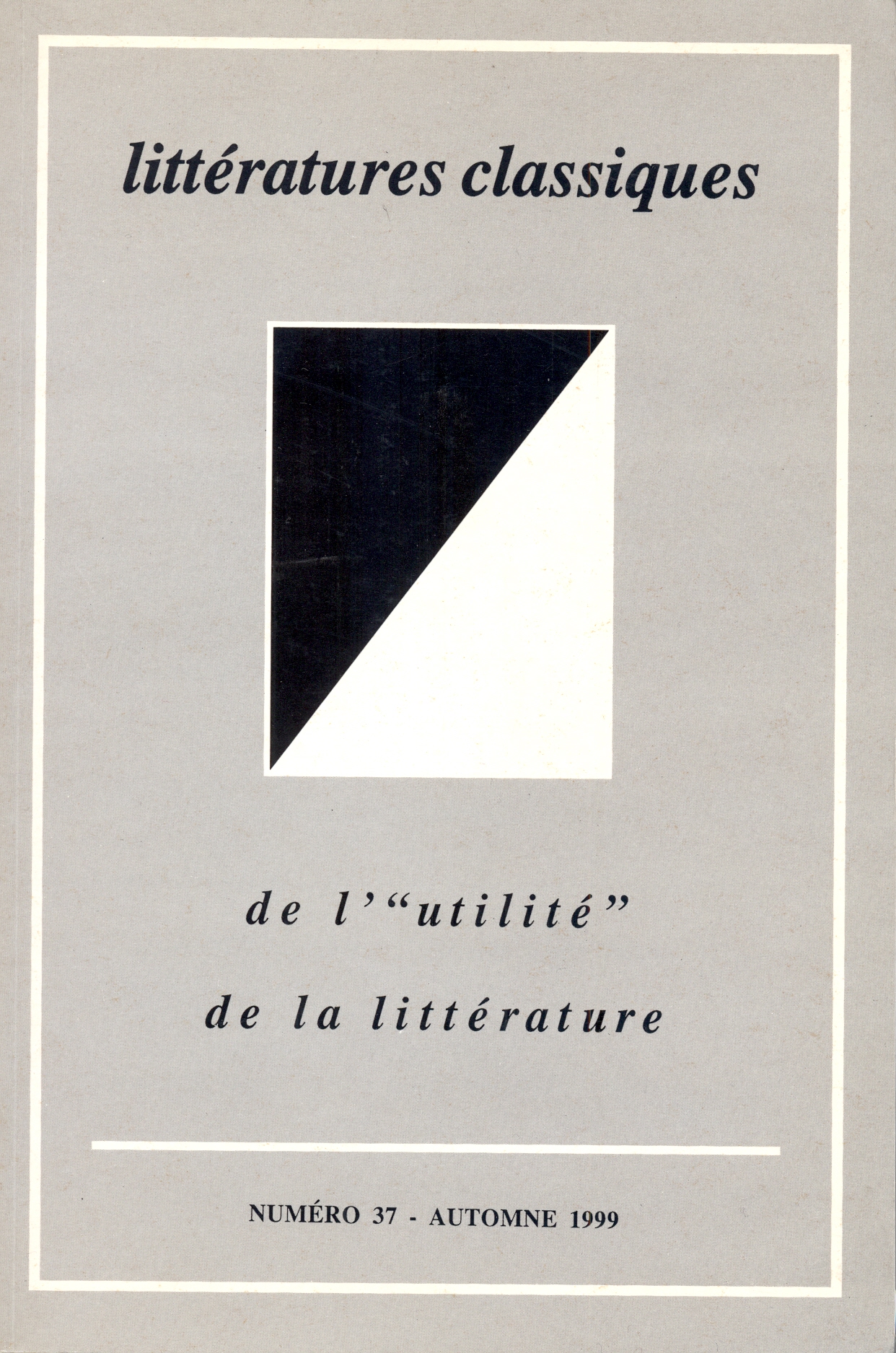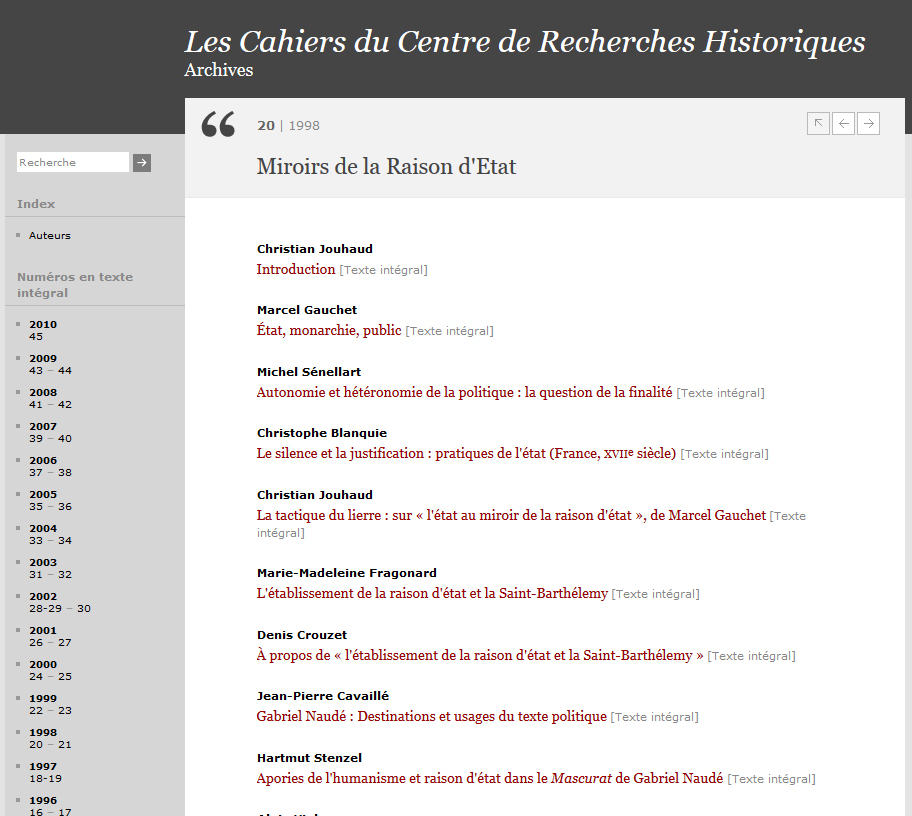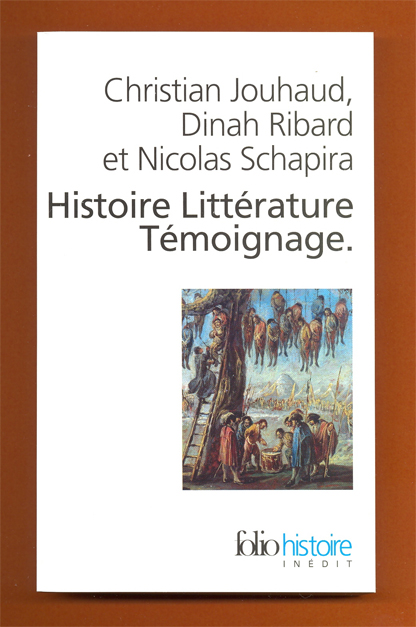Publications
Capitales érudites. Écrits et savoirs à Lisbonne et à Madrid (XIXe-XXe siècle)
Prix : 46 euros
Au cours des XIXe et XXe siècles, Madrid et Lisbonne font l’objet d’un intense investissement érudit. La municipalité madrilène décerne à plusieurs reprises le titre de Chroniqueur officiel de la ville. À Lisbonne, un savoir spécifique consacré à la capitale portugaise est élaboré, l’olisipographie. La formation et le développement de ces deux éruditions locales sont étudiés de manière comparée entre champ littéraire, monde érudit et institution municipale. Il s’agit de restituer ces savoirs par l’analyse des écrits qui les portent et des pratiques d’écriture qui les mettent en œuvre. Les recherches qui ont été menées témoignent du rapport des acteurs de l’époque aux sources et archives urbaines.
Blaise Pascal - Pensées
Edition d'Alain Cantillon
Comment lire aujourd'hui les papiers laissés par Pascal à sa mort ? Cette nouvelle édition des Pensées, due à Alain Cantillon, repose sur trois principes essentiels, qui la démarquent des précédentes.
Elle sépare radicalement les écrits de la main de Pascal et ceux d'autres mains, dont la fiabilité est douteuse. Elle offre une mise en ordre thématique des pensées à la fois éclairante et d'un accès plus facile. Elle s'attache à conserver la ponctuation originale, et donc à restituer le rythme propre et la beauté de la prose pascalienne.
L'enjeu est de permettre, au XXIe siècle, une réactivation de la puissance critique des Pensées et un rapport nouveau aux manuscrits, désormais accessibles en quelques clics.
ISBN : 978-2-36280-307-9
Fiche éditeur : https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782362803079-pensees-blaise-pascal-alain-cantillon/
Le Menuisier de Nevers. Poésie ouvrière, fait littéraire et classes sociales (XVIIe-XIXe siècle)
Prix : 25 euros
Le Menuisier de Nevers est un nom d’auteur. C’est même le premier à être devenu célèbre parce que celui qui s’en servait proclamait dans ses livres qu’il était un ouvrier. Tout ici est étonnant : la date d’abord, autour de 1640, bien en amont de l’industrialisation de la France et d’une démocratisation de la culture ; la disparition complète du canon littéraire, ensuite, de ce poète longtemps fameux, réédité, lu et commenté, qui s’appelait en fait Adam Billaut.
La chronologie de la poésie ouvrière pose le problème historique qui se trouve au coeur de ce livre. La littérature n’a pas attendu que les ouvriers deviennent des acteurs de l’histoire, au XIXe siècle, pour consacrer des auteurs issus du peuple laborieux. L’apparition de ce travailleur manuel sur la scène littéraire à l’époque de Louis XIV prouve que la littérature n’enregistre pas le mouvement de l’histoire : elle est une forme d’action qui transforme les voies d’accès à la parole publique et façonne l’histoire des classes sociales.
Au cours des deux siècles suivants, on a trouvé naïve et populaire la poésie très savante de ce « Virgile au rabot ». Exception glorieuse dans une société férocement hiérarchique, sa figure a maintenu hors de la littérature les très nombreux artisans qui ont composé des vers dans cette période. Elle a ensuite été relayée par les ouvriers poètes qui ont intéressé un moment les éditeurs et écrivains progressistes de l’époque industrielle. En retrouvant tout ce peuple d’auteurs, Dinah Ribard montre que la littérature est une contribution essentielle à l’histoire de l’inégalité.
Ne pas finir
Dialogue de deux historiens à propos de L’écharpe rouge d’Yves Bonnefoy
La lecture partagée de L’écharpe rouge d’Yves Bonnefoy, dernière œuvre – en prose – d’un grand poète, est la source de ce livre. Le dialogue qu’ont conduit les deux auteurs est né d’une double énigme, qui les a doublement intrigués. Ils ont, d’une part, rencontré l’énigme d’un ouvrage tout à la fois testamentaire et inaugural, sans cesse saisi et transporté par l’énergie d’un recommencement. D’autre part, parmi les multiples entrées offertes au lecteur par Bonnefoy, ils ont été confrontés à l’énigme d’une enquête menée par un narrateur à la recherche d’une image qui retiendrait en elle le chiffre d’une vie (et qui rend peut-être compte de l’intimité contrariée du poète avec la psychanalyse). Cette enquête, ils l’ont vite découvert, lève sur son passage d’innombrables autres images et d’autres écrits eux mêmes hantés par l’image introuvable. C’était là se retrouver au cœur du problème de l’image, tel que Bonnefoy n’a cessé de le penser et de l’écrire, aussi bien dans son œuvre poétique que dans ses textes théoriques ou historiques.
Autre entrée peut-être plus surprenante, le dialogue a permis de mesurer à quel point des notions comme celles de présence ou de finitude, si familières a` l’auteur de L’écharpe rouge, s’ouvraient, par leur étonnante fécondité historiographique, aux attentes de deux historiens de l’expérience.
Réunies autour d’une lecture qui n’est pas seulement celle d’un livre mais d’une œuvre entière, les deux voix de ce dialogue voudraient aussi inciter qui les lira à faire l’expérience sans fin des figures de soi autour desquelles s’enroulent les écharpes rouges d’Yves Bonnefoy.
Définir la noblesse
Écriture et publication des traités nobiliaires au XVIIe siècle – Angleterre - France - Espagne
Prix : 25 euros
D ans les sociétés européennes du XVIIe siècle, sauf exceptions, les gens naissaient et demeuraient inégaux en droits. La noblesse représentait un statut largement convoité, mais sa définition faisait l’objet de controverses incessantes, exprimées par des livres publiés par centaines : les traités nobiliaires. Qui était noble et qui ne l’était pas ? Comment justifier cette distinction fondamentale ? Comment définir la noblesse des femmes ? Pouvait-on devenir noble ? Que signifiait la rhétorique du « sang » et de l’« occulte semence » ? C’est sur ces problèmes sociaux que s’écharpaient les théoriciens dans l’Espagne des derniers Habsbourg, dans l’Angleterre des Stuarts et de la guerre civile, ainsi que dans la France d’Henri IV, de Louis XIII et de Louis XIV.
Ce livre met en lumière les auteurs, les traducteurs et les libraires impliqués dans la production des traités nobiliaires, ainsi que leurs lecteurs. Il propose un regard comparatif sur les théoriciens et les traités anglais, français et espagnols. En analysant les interactions entre média et société, et en envisageant l’écriture et la publication comme des actions, cette enquête interroge l’intensité, la permanence et les enjeux de ces luttes de définition de l’ordre social.
Publié avec le soutien de Nantes Université et de la Société d'étude du XVIIe siècle.
Les chroniqueurs d’Aragon et les pouvoirs de l’écrit. Les tisseurs du temps
À partir d’un point de vue décentré, celui du royaume d’Aragon, ce travail analyse les processus d’écriture de l’histoire officielle à travers le groupe des chroniqueurs officiels d’Aragon et plus largement des autres chroniqueurs officiels de la monarchie. Cette écriture collective est issue de collaborations codifiées propres au monde savant, d’intenses négociations nouées entre roi, royaume, localités et particuliers, mais également nouées par le rapport parfois houleux aux commanditaires, par la traversée toujours délicate des dispositifs de censure (religieuse, régnicole et royale) et par les difficultés que rencontrent nos chroniqueurs pour consulter certaines archives réservées. En partant de la matérialité des écrits et de l’imbrication des réseaux savants et politiques et en restituant les opérations pragmatiques qui vont de la délimitation du dicible et du mémorable à leur transformation en livre, c’est toute une histoire de la formation, de la circulation et de la manutention de l’information historiographique qui se dessine. L’histoire peut être considérée à la fois comme une écriture de service et comme un ensemble de pratiques et de gestes intellectuels dont la validation comme savoir et l’horizon de recevabilité se forgent dans des interactions corsetées par des codes sociaux et des impératifs politiques. Mais il s’agit aussi de montrer comment l’élaboration (collaborative ou conflictuelle) de ces récits d’un passé commun contribue dans son mouvement même, à articuler territoires et communautés à l’échelle de la monarchie à partir de leurs particularismes. Sans nous laisser enfermer dans le face à face roi/royaume, nous cherchons à établir une histoire de la monarchie composite espagnole pensée comme corps communicationnel, tant il est vrai que les discours sur le passé résultent de négociations entre des forces sociales et des institutions qui impliquent toute la péninsule.
L'Adhésion littéraire
Prix : 18 €
L’Adhésion littéraire est un essai court (moins de 200 pages) et d’une lecture aisée, adressé à tous ceux qui aiment la littérature et la font vivre, qu’ils soient simples lecteurs et lectrices, enseignants, bibliothécaires, libraires… Plutôt que de revenir à la vieille question « qu’est-ce que la littérature ? », Alain Viala pose la question : « que faisons-nous quand nous faisons de la littérature ? ». À partir de textes classiques (Racine, Proust) aussi bien que populaires (La Chanson de Craonne), il refuse le discours réactionnaire de la « crise de la littérature », engage un dialogue polémique avec Antoine Compagnon, revendique une conception large et ouverte de la littérature et en affirme la nécessité pour la démocratie.
ISBN : 978-2-37071-251-6
Ecriture du groupe. Ecriture en groupe
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/9649
Ce numéro des Dossiers du Grihl est le deuxième volet d’une enquête qui aborde le fait littéraire à partir du problème spécifique des collectifs. Telle qu’ils nous arrivent du passé après nombre d’opérations éditoriales et critiques, telle qu’ils sont largement configuré par l’histoire littéraire, les écrits nous apparaissent pour une bonne part dans une perspective « groupale » qui contribue à opacifier notre appréhension dans le passé de ce que Lanson a appelé le « fait social de la littérature ». Une partie des contributions de ce volume travaille ainsi à interroger les fictions de groupes qu’ont produites non seulement l’histoire littéraire mais les opérations éditoriales du XVIIe siècle qui réunissaient des pièces poétiques, collectaient des fragments, rassemblaient des lettres. « Trio d’acteurs », groupement de conteuses, académies instituées, « ordinaires » ou fantasmées, pratiques poétiques ou épistolaires, République des Lettres : qu’en fut-il de la réalité de ces « groupes » transmis par l’histoire ? Comment comprendre le surgissement du « groupe », parfois du « corps », dans la désignation des pratiques sociales des acteurs du passé qui furent des professionnels de l’écriture, mobilisèrent la « littérature » ou furent enrôlés dans l’institution du littéraire? et dans quelle mesure ces « groupes » travaillaient-ils avec les autres appartenances et les intérêts de ces acteurs ? L’enquête collective proposée dans ce numéro du Grihl auquel contribuent plusieurs jeunes chercheurs en histoire et en littérature peut ainsi se lire comme une enquête sur la production et les fictions du social par l’écriture et la littérature. Et elle est une invitation à prendre en charge, dans la réflexion sur cette question si constituée des « écritures collectives », les modalités d’ordonnancement voire d’archivage des écrits, ainsi que les opérations de littérarisation et de production de la valeur indissociables de leur transmission.
Sommaire
Laurence Giavarini, Écrire le groupe, écrire en groupe : pour une histoire du fait social de la littérature sous l’Ancien Régime
1.1. Le travail du fait littéraire : Groupements et collectifs
Flavie Kerautret, Le « trio » de farceurs de l’Hôtel de Bourgogne. Penser la construction du collectif théâtral
Elise Roussel, Le « groupe des conteuses » de la fin du XVIIe siècle : une construction ? Le cas de Marie-Jeanne L’Héritier de Villandon
1.2. Le travail du fait littéraire : trompe-l’oeil
Nicolas Schapira, Tallemant des Réaux et ses amis dans le Manuscrit 19142. Le groupe par la mise en recueil
Stephanie Bung, Le Recueil Lauvergne(1680) de Claude Barbin. Écriture en groupe ou coup d’éditeur ?
Juliette Deloye, Écriture du groupe et institution. Retour sur l’Académie politique de Torcy
2. Faire corps par l’écriture
Sophie Houdard, Jean-Joseph Surin et le Royaume intérieur. La construction d’un groupement volontaire spirituel
Léa Renucci, Épistolairement vôtre. Faire académie à l’Arcadia au XVIIIe siècle
Maxime Martignon, Usages et désignation du groupe chez les nouvellistes du temps de Louis XIV
3. Retour sur la « République des Lettres »
Laurent-Henri Vignaud, Biens précieux et actions épistolaires. L’économie du savoir dans la République des Lettres au XVIIe siècle
Le Siècle de Marie Du Bois - Ecrire l'expérience au XVIIe siècle
Prix : 25 euros
Comment penser et écrire une histoire de l’expérience de vivre ? Telle est la question posée par Christian Jouhaud à partir de « l’espèce de journal » tenu pendant trente ans par Marie Du Bois, gentilhomme du Vendômois, valet de chambre des rois Louis XIII et Louis XIV. Cet écrit singulier surprend d’abord par la difficulté de lui trouver un statut : ce n’est ni un livre de raison, ni une autobiographie, ni un journal spirituel, ni une histoire, et pourtant il peut être abordé sous tous ces aspects.
Il ne s’agit pas non plus d’une histoire de vie, mais d’une histoire des expériences d’un homme « ordinaire » en ses territoires de vie. Le je de Du Bois, qui s’exprime continûment, ne sert en effet aucun épanchement autobiographique, mais, de page en page, il permet de comprendre l’itinéraire de l’intériorisation des normes et des contraintes par quelqu’un qui a confié à l’activité d’écrire régulièrement la représentation de sa vie comme action. L’exercice pourrait sembler futile, ou mineur, si l’événement politique ne venait pas brutalement fracasser la mécanique diariste, finissant par politiser l’écriture, par exemple dans l’expérience intime de signes de désordre, comme pendant la Fronde, qui menacent la lisibilité d’un monde dont l’ordre est la valeur cardinale.
Depuis la chambre du roi et la campagne du Vendômois sont ainsi revisités les rapports entre local et national au XVIIe siècle, l’histoire politique de l’État, l’histoire anthropologique de l’acte d’écrire et de transmettre par l’écriture, inscrivant, dans le siècle de Louis XIV, un siècle de Marie Du Bois.
Crises et renouveaux du geste hagiographique. Les Vies de Jeanne de Chantal (XVIIe et XXe siècles)
La condamnation par l'Index de la Sainte Chantal de Henri Bremond (1912) est le point de perspective de l'étude sur Les Vies de Jeanne de Chantal, qui donnent à lire les nouveaux saints du XVIIe siècle. Mais ce retour au XVIIe siècle est un geste polémique : écrire une Vie, c'est reconstruire ce qu'est la sainteté.
GRIHL II - Autorité(s) dans la littérature, Autorité(s) de la littérature
GRIHL II - Autorité(s) dans la littérature, Autorité(s) de la littérature est le deuxième livre issu du travail commun du Grihl et de ses partenaires japonais, qui animent depuis plusieurs années la discussion, au sein des études françaises au Japon, sur les rapports entre histoire et littérature ; le premier a paru en 2017. Ce second volume rassemble les contributions à un colloque consacré aux questions d'autorité dans, sur et par la littérature qui a été une des étapes de cette discussion ; il est dirigé par Yasushi Noro (Université d'Okayama), ancien professeur invité à l'EHESS et accueilli à cette occasion au CRH, qui avait organisé ce colloque en septembre 2017.
TABLE DES MATIÈRES
Les autorités mises en écrit et en action, Yasushi NORO
Première Partie : Littérature(s) et autorité(s)
Chapitre 1 : « Qu'est-ce qu'un auteur "extraordinaire" ? - À partir des marges du champ culturel à l'âge classique »
1. « L'autorité paternelle et l'auctoriarité mineure : sur le sujet de l'écriture chez Rétif de La Bretonne », Atsuo MORIMOTO
2. « Sur les « Auteurs » des Fêtes de Ramire : lecture d’un passage des Confessions de Rousseau », Shojiro KUWASE
3. « L’auteur en excès. Deux inconnus des Lumières, Cassier et Déforges-Maillard », Dinah RIBARD
Chapitre 2 : « La construction de l'événement : autorité historique et autorité historiographique »
1. « La construction de l'autorité des mémorialistes du temps de la Fronde », Christian JOUHAUD
2. « La mort de Louis XIV et l'autorité des témoignages : journal, mémoires et historiographie », Hiroaki SHIMANAKA
Chapitre 3 : « Autorité politique et autorité littéraire : XIXe et XXe siècles »
1. « Légiférer sur la fiction littéraire ? L’amendement Riancey, 1850 » Judith LYON-CAEN et Keiko TSUJIKAWA
2. « L'engagement anti-intellectuel de Céline - les années 20 et 30 », Yoriko SUGIURA
Chapitre 4 : « Écriture de la censure et autorité : XVIIe et XIXe siècle »
1. « L'approbation des docteurs au XVIIe siècle : les usages d'une littérarisation », Nicolas SCHAPIRA
2. « Jouer ou déjouer l'autorité sous la IIIe République : discours sur les livres censurés », Hiroyuki NAKAHATA
Chapitre 5 : « Autorités au pluriel »
1. « Autorité(s) de derrière : autorités dans la polémique autour de De la fréquente communion d'Antoine Arnauld », Yasushi NORO
Deuxième Partie : Problèmes de la représentation de l'histoire
1. « Frontière des mazarinades », Christian JOUHAUD
2. « "Cela ne s'est pas passé comme ça" : premières représentations de l'irreprésentable après la Shoah », Judith LYON-CAEN
Postface : Hiroyuki NAKAHATA
Bussy-Rabutin en sa tour dorée
Prix : 15 euros
Exilé en Bourgogne en 1666 après le scandale de l’Histoire amoureuse des Gaules, Bussy-Rabutin entreprend de réparer sa fortune et d’embellir ses maisons. Le décor de son appartement est refait à son goût et à son image suivant un programme décoratif qu’il a défini et commenté. Lambris mythologiques, portraits, allégories et cartels traduisent sa culture, illustrent son lignage et décrivent son monde. Identifier la source de chacun des éléments du décor de sa Tour dorée, en retrouver les références anciennes et modernes, c’est donc comprendre le travail de sa composition et matérialiser le rapport des visiteurs et lecteurs à une œuvre jouant volontiers sur les images.
Edition en ligne : https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/8594
Edition papier : https://www.i6doc.com/fr/book/?gcoi=28001100260650
Sommaire :
Les Métamorphoses de la Tour dorée
Maîtres et secrétaires (XVIe - XVIIIe siècles) - l'exercice du pouvoir dans la France d'ancien régime
Prix : 24 euros
Secrétaire, secrétariat : une figure aujourd'hui omniprésente, une présence qui va de soi. Il fut un temps où le secrétaire était un domestique, un intime, gardien des secrets et des affaires privées de son maître.
L'enquête de Nicolas Schapira met en lumière l'apparition de ce couple, où l'un décide tandis que l'autre conseille, écrit, et tient mémoire. C'est entre Renaissance et âge des Lumières, au moment où le papier devient le support de toute décision, que paraît ce personnage nouveau, pouvant être simple scribe comme conseiller des princes, reconnu pour son expertise. Quelle que soit sa condition, le secrétaire est une silhouette de l'ombre : des traités sont écrits pour louer son action et ses compétences, mais les contemporains dénoncent son influence excessive et son ubiquité.
Associant les méthodes de l'histoire et des sciences sociales, ce livre raconte l'ascension d'un groupe qui ne s'identifiait ni à un métier ni à un statut, mais dont le pouvoir s'accrut à mesure que l'État se construisait sous l'Ancien Régime et qu'il pénétrait progressivement toutes les strates de l'administration, jusqu'à nos jours.
Poétique de l’extase France, 1601-1675
Qu’y a-t-il de commun à l’extase des saints et des poètes, des sorciers et des prophètes, de la théologie et de la mélancolie, des philosophes et des illuminés qui vocifèrent leurs cantiques ? Un excès qui poétise les corps, les comportements, la langue et les savoirs, leur imprimant la marque d’une loi autre que celle dont ils sont jugés. Une défaillance du sens, qu’une littérature composée de récits (auto)biographiques, de traités de spiritualité et de poésie lyrique a voulu prendre en charge en France au XVIIe siècle, avant que l’extase ne soit définitivement reléguée aux franges des bienséances et de la religion.
1969 : Michel Foucault et la question de l'auteur
"Qu'est-ce qu'un auteur ?"
Michel Foucault donne en 1969 à Paris, puis en 1970 aux États-Unis, une conférence sur la question de l’auteur dont la formule-clé, « Qu’importe qui parle », est empruntée à Samuel Beckett. Il existe plusieurs manières de donner un contexte aux propositions avancées dans ce texte qui fit événement, de raconter l’histoire de son impact sur la théorie, la critique, l’histoire du fait littéraire, d’y réagir enfin. On s’efforce ici d’éclairer ces interprétations, ces récits, leurs évolutions et leurs enjeux, en s’intéressant notamment à leur caractère contradictoire, ainsi qu’à l’importance qu’ont eue, pour l’évolution des études littéraires, des choses que Foucault ne dit pas dans « Qu’est-ce qu’un auteur ? ».
La Griffe du temps : Ce que l'histoire peut dire de la littérature
Prix : 22 euros
Aux devantures des librairies, on ne compte plus les ouvrages d'historiens réfléchissant gravement à leur rapport avec la littérature. Doivent-ils en faire une source de leur savoir, mais en contextualisant la fiction depuis leur surplomb, au risque de ne pas faire mieux que l'histoire littéraire et manquer ce que fait la littérature ? Ou bien recourir à l'écriture de la fiction, quitte à s'installer prosaïquement dans l'entre-deux-genres d'une classique monographie ? Judith Lyon-Caen propose une aventure plus ambitieuse : à partir d'une nouvelle de Jules Barbey d'Aurevilly, « La vengeance d'une femme », l'historienne part de ce qu'est la littérature : une expérience d'être au monde, pour mesurer l'éclairage que sa discipline peut apporter à la mise en écriture romanesque. Ainsi de ces myriades d'objets, de parures, de rues et boulevards ou de lieux parisiens dont la description a pour fonction d'attester la réalité du récit : l'historien décrypte ces traces du temps, que ce soit le temps de la rédaction ou celui de l'action du récit, en retrouve l'origine, réfléchit à la manière dont le romancier en a été affecté. Non pas pour réduire l'écriture romanesque à un ancrage dans une époque, mais, au contraire, pour éclairer comment une époque nourrit le sens d'une écriture. L'historien en « herméneute » du matériau littéraire, en quelque sorte. Une invitation à apprendre à mieux lire ce qui fait la littérature et ce que fait un romancier.
Ecriture du groupe. Ecriture en groupe
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/9649
Ce numéro des Dossiers du Grihl est le deuxième volet d’une enquête qui aborde le fait littéraire à partir du problème spécifique des collectifs. Telle qu’ils nous arrivent du passé après nombre d’opérations éditoriales et critiques, telle qu’ils sont largement configuré par l’histoire littéraire, les écrits nous apparaissent pour une bonne part dans une perspective « groupale » qui contribue à opacifier notre appréhension dans le passé de ce que Lanson a appelé le « fait social de la littérature ». Une partie des contributions de ce volume travaille ainsi à interroger les fictions de groupes qu’ont produites non seulement l’histoire littéraire mais les opérations éditoriales du XVIIe siècle qui réunissaient des pièces poétiques, collectaient des fragments, rassemblaient des lettres. « Trio d’acteurs », groupement de conteuses, académies instituées, « ordinaires » ou fantasmées, pratiques poétiques ou épistolaires, République des Lettres : qu’en fut-il de la réalité de ces « groupes » transmis par l’histoire ? Comment comprendre le surgissement du « groupe », parfois du « corps », dans la désignation des pratiques sociales des acteurs du passé qui furent des professionnels de l’écriture, mobilisèrent la « littérature » ou furent enrôlés dans l’institution du littéraire? et dans quelle mesure ces « groupes » travaillaient-ils avec les autres appartenances et les intérêts de ces acteurs ? L’enquête collective proposée dans ce numéro du Grihl auquel contribuent plusieurs jeunes chercheurs en histoire et en littérature peut ainsi se lire comme une enquête sur la production et les fictions du social par l’écriture et la littérature. Et elle est une invitation à prendre en charge, dans la réflexion sur cette question si constituée des « écritures collectives », les modalités d’ordonnancement voire d’archivage des écrits, ainsi que les opérations de littérarisation et de production de la valeur indissociables de leur transmission.
Sommaire
Laurence Giavarini, Écrire le groupe, écrire en groupe : pour une histoire du fait social de la littérature sous l’Ancien Régime
1.1. Le travail du fait littéraire : Groupements et collectifs
Flavie Kerautret, Le « trio » de farceurs de l’Hôtel de Bourgogne. Penser la construction du collectif théâtral
Elise Roussel, Le « groupe des conteuses » de la fin du XVIIe siècle : une construction ? Le cas de Marie-Jeanne L’Héritier de Villandon
1.2. Le travail du fait littéraire : trompe-l’oeil
Nicolas Schapira, Tallemant des Réaux et ses amis dans le Manuscrit 19142. Le groupe par la mise en recueil
Stephanie Bung, Le Recueil Lauvergne(1680) de Claude Barbin. Écriture en groupe ou coup d’éditeur ?
Juliette Deloye, Écriture du groupe et institution. Retour sur l’Académie politique de Torcy
2. Faire corps par l’écriture
Sophie Houdard, Jean-Joseph Surin et le Royaume intérieur. La construction d’un groupement volontaire spirituel
Léa Renucci, Épistolairement vôtre. Faire académie à l’Arcadia au XVIIIe siècle
Maxime Martignon, Usages et désignation du groupe chez les nouvellistes du temps de Louis XIV
3. Retour sur la « République des Lettres »
Laurent-Henri Vignaud, Biens précieux et actions épistolaires. L’économie du savoir dans la République des Lettres au XVIIe siècle
GRIHL II - Autorité(s) dans la littérature, Autorité(s) de la littérature
GRIHL II - Autorité(s) dans la littérature, Autorité(s) de la littérature est le deuxième livre issu du travail commun du Grihl et de ses partenaires japonais, qui animent depuis plusieurs années la discussion, au sein des études françaises au Japon, sur les rapports entre histoire et littérature ; le premier a paru en 2017. Ce second volume rassemble les contributions à un colloque consacré aux questions d'autorité dans, sur et par la littérature qui a été une des étapes de cette discussion ; il est dirigé par Yasushi Noro (Université d'Okayama), ancien professeur invité à l'EHESS et accueilli à cette occasion au CRH, qui avait organisé ce colloque en septembre 2017.
TABLE DES MATIÈRES
Les autorités mises en écrit et en action, Yasushi NORO
Première Partie : Littérature(s) et autorité(s)
Chapitre 1 : « Qu'est-ce qu'un auteur "extraordinaire" ? - À partir des marges du champ culturel à l'âge classique »
1. « L'autorité paternelle et l'auctoriarité mineure : sur le sujet de l'écriture chez Rétif de La Bretonne », Atsuo MORIMOTO
2. « Sur les « Auteurs » des Fêtes de Ramire : lecture d’un passage des Confessions de Rousseau », Shojiro KUWASE
3. « L’auteur en excès. Deux inconnus des Lumières, Cassier et Déforges-Maillard », Dinah RIBARD
Chapitre 2 : « La construction de l'événement : autorité historique et autorité historiographique »
1. « La construction de l'autorité des mémorialistes du temps de la Fronde », Christian JOUHAUD
2. « La mort de Louis XIV et l'autorité des témoignages : journal, mémoires et historiographie », Hiroaki SHIMANAKA
Chapitre 3 : « Autorité politique et autorité littéraire : XIXe et XXe siècles »
1. « Légiférer sur la fiction littéraire ? L’amendement Riancey, 1850 » Judith LYON-CAEN et Keiko TSUJIKAWA
2. « L'engagement anti-intellectuel de Céline - les années 20 et 30 », Yoriko SUGIURA
Chapitre 4 : « Écriture de la censure et autorité : XVIIe et XIXe siècle »
1. « L'approbation des docteurs au XVIIe siècle : les usages d'une littérarisation », Nicolas SCHAPIRA
2. « Jouer ou déjouer l'autorité sous la IIIe République : discours sur les livres censurés », Hiroyuki NAKAHATA
Chapitre 5 : « Autorités au pluriel »
1. « Autorité(s) de derrière : autorités dans la polémique autour de De la fréquente communion d'Antoine Arnauld », Yasushi NORO
Deuxième Partie : Problèmes de la représentation de l'histoire
1. « Frontière des mazarinades », Christian JOUHAUD
2. « "Cela ne s'est pas passé comme ça" : premières représentations de l'irreprésentable après la Shoah », Judith LYON-CAEN
Postface : Hiroyuki NAKAHATA
Michel de Certeau et la littérature
Sous la direction de Jean-Christophe ABRAMOVICI et Christian JOUHAUD
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/6799
Version papier en impression à la demande (https://www.i6doc.com/fr/book/?gcoi=28001100577920),
Les Dossiers du Grihl, 2018, n°2, Paris, Centre de Recherches Historiques, 392 p.
ISBN : 978-2-908452-08-2
PRESENTATION
La littérature dans l’œuvre de Michel de Certeau, c’est un peu comme le bocage où l’arbre est partout et la forêt nulle part. Les mots du littéraire foisonnent (littérature, roman, fiction, poétique, etc.), qu’il s’agisse de mystique, de psychanalyse, des cultures contemporaines, de l’écriture de l’histoire. Mais ces mots que désignent-ils exactement, de quoi sont-ils les noms ou les opérateurs ? Quel « pratiquant » de la « littérature » révèlent-ils ? Et quel écrivain ?
Les vingt communications issues du colloque « Michel de Certeau et la littérature » publiées dans ce volume apportent des réponses à ces questions. Elles le font en visant trois objectifs : dresser un état des lieux du littéraire certalien ; décrire et comprendre pourquoi et comment Certeau historien a constamment envisagé l’historiographie la plus rigoureuse comme « fiction » et comme « littérature » ; saisir comment la problématique des actes de lecture débouche sur une éthique et une politique de la présence et de l’absence. Elles le font aussi en tentant de prendre la mesure des potentialités théoriques du recours à la littérature chez Certeau qui a écrit que « la littérature est le discours théorique des procès historiques » et que le roman « c’est le rapport que la théorie entretient avec l’apparition événementielle de ses limites ».
SOMMAIRE
Fable
Patrick Goujon et Sophie Houdard : Jean-Joseph Surin et « L’illettré éclairé » : une série littéraire (1968-1982), p. 9-26.
Diana Napoli : La Fable mystique : une phénoménologie de l’écriture, p. 27-44.
Clément Duyck : Le faire poétique chez Michel de Certeau, p. 45-60.
Historio-graphies
Andrés G. Freijomil : Pratique du réemploi textuel et lecture de soi-même chez Michel de Certeau, p. 63-74.
Christian Jouhaud : « Roman » psychanalytique et écriture de l’histoire, p. 75-90.
Denis Pelletier : Histoire, littérature et psychanalyse. Michel de Certeau et l’école des Annales (1974-1975), p. 91-108.
Agnès Guiderdoni : De quel genre littéraire l’hagiographie est-elle le nom chez Michel de Certeau ?, p. 109-122.
Ecriture(s)
Michèle Clément : Michel de Certeau : critique et pratique de la littérature, p. 125-142.
Boris Lyon-Caen : Certeau cannibale ? Les ressources de la « relation “ethnographique” », p. 143-156.
Alain Cantillon : « Le supplément défectueux », p. 171-192.
Dinah Ribard : La première personne du singulier, p. 193-208.
Norihiro Morimoto : « Introït à l’écriture » : Michel de Certeau et les préfaces des mystiques, p. 209-224.
Fictions
Laurence Giavarini : La fiction-sorcière : contre la littérature ?, p. 227-244.
Annick Louis : Le concept de braconnage. Présences de Borges dans l’œuvre de Michel de Certeau, p. 245-262.
Daniel Wanderson Ferreira : Michel de Certeau et l'écriture poétique de l'histoire, p. 263-274.
Mohammed Chaouki Zine : L’instant littéraire. Une “tactique” dans la configuration du savoir moderne d’après Michel de Certeau, p. 275-308.
Traces
Romuald Fonkoua : Paroles et prises de parole chez les "écrivains subalternes", p. 311-328.
Nicolas Schapira : Quand le diable écrit et publie. Le littéraire comme pratique sociale dans la correspondance de Surin et La Possession de Loudun, p. 329-342.
Jean-Christophe Abramovici :Les traces littéraires dans La Fable mystique, p. 343-354.
François Trémolières : Conclusions, p. 357-360.
A l'enseigne du Grihl - Quelques parcours en histoire du littéraire
Les Dossiers du Grihl, 2017-02 (https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/6769)
Version papier en impression à la demande : https://www.i6doc.com/fr/book/?gcoi=28001100419350
En vingt ans d’existence, le Grihl, fondé en 1996, a accueilli des chercheurs venus de divers lieux, de divers pays, pour des séjours de recherche plus ou moins longs, pour des visites épisodiques ou régulières. A l’occasion de cet anniversaire, nous avons souhaité leur donner la parole. Le jeu était simple dans son principe et n’imposait aucune règle préalable : chacun pouvait, s’il le souhaitait, envoyer une contribution, avec toute liberté quant à la forme et au sujet de celle-ci. La seule requête était qu’elle manifeste ce que le Grihl avait apporté ou apportait encore, ou non, à leurs propres recherches.
Quatorze contributions ont été regroupées en trois ensembles : terrains et figures, lectures et mises en contexte, regards et images. Ce dossier « à l’enseigne du Grihl » s’ouvre, sous la forme d’un récit, sur une réflexion à propos de la dimension nationale des parcours académiques et se clôt avec un film, sur une réflexion en image donc, à propos d’une peinture allégorique, une allégorie politique du bon gouvernement qui pourrait aussi passer pour une figure de la bonne interdisciplinarité.
Table des matières
Christian Jouhaud et Alain Viala : Introduction
Un parcours académique et le Grihl : vu d'Allemagne
Harmut Stenzel (Universität Giessen) : Vu d’Allemagne : Mon parcours académique et le GRIHL
Terrains et figures
Yasushi Noro (Université d'Okayama) : L’image de feu Saint-Cyran. Un autre regard sur la bibliographie littéraire
Geoffrey Turnovsky (University of Washington, Seattle, WA) : Chroniques des Chroniques du Samedi : l’invention d’un manuscrit
Oded Rabinovitch (Université de Tel Aviv) : écriture et action dans les vies d’Antoine Arnauld et Blaise Pascal (1696) : pour un pont historiographique
Kate E. Tunstall (Oxford University, Worcester College) : La fabrique du Diderot-philosophe, 1765-1782
Cinthia Meli (Université de Genève) : Crise de Lettres : La Réception de Malherbe au tournant du XXe siècle
Andrés G. Freijomil (Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires) : Politique et mystique chez René d’Argenson. La lecture novatrice de Michel de Certeau
Lectures et mises en contextes
Michael Randall (Brandeis University, MA) : Montaigne et des juges véreux
Jörn Steigerwald (Universität Paderborn) : De la vengeance d’une femme à la tragédie de la famille : Écriture et problématisation de l’action féminine dans Médée de Corneille
Xenia von Tippelskirch (Humboldt-Universität zu Berlin) : « J’y souffre ce qui ne se peut comprendre ni exprimer » Souffrances d’une mystique abandonnée de Dieu (1673-1674)
Barbara Selmeci Castioni (Fonds national suisse de la recherche scientifique) : Donneau de Visé, amateur d’estampes et visionnaire. Le Mercure galant en 1686
Regards et images
Déborah Blocker (University of California, Berkeley) : Tous pour un et un pour tous ou de l’activité de penser en commun mais non en rond(s)
Albert Schirrmeister (Institute for Advanced Study Konstanz) : Travailler avec le Grihl
Une recherche-création
Eric Méchoulan (Université de Montréal) : Une disparition. Enquête sur un tableau de cheminée d'Eustache Le Sueur
ISSN : 1958-9247
Ecrire les écritures. Hommage à Daniel Fabre
Des écritures ordinaires à l’approche anthropologique des pratiques littéraires, les livres et les articles de Daniel Fabre accordent une place primordiale à l’écrit. Les contributions rassemblées dans ce volume tentent d’explorer cette centralité. Issues d’un colloque tenu à l’EHESS en septembre 2016, elles ne proposent pas un regard panoramique sur une œuvre dont on commence à peine à mesurer la richesse et l’ampleur ; elles en explorent plutôt quelques cantons où, à chaque fois, les questions soulevées à propos de l’écriture comme pratique de symbolisation du monde se trouvent abordées avec la même intensité. Les objets et les terrains de Daniel Fabre changent, mais il n’y en a pas de principaux et de secondaires : l’acuité du regard et l’engagement intellectuel ne fléchissent pas, qu’il s’agisse des rapports entre écrit et oral, du corps de l’écrivain, des institutions de la littérature, de l’autobiographie ou de l’historicité des pratiques. à chaque fois, part est faite à la réflexivité : comment se tenir en tant qu’anthropologue face à la littérature aussi bien que face à l’écrit « ordinaire » ? Les douze auteurs rassemblés dans ce volume rendent hommage au travail de Daniel Fabre et surtout montrent en quoi ses hypothèses, ses problématiques, ses conclusions et son écriture prennent sens dans leurs propres recherches. Sur ce plan, Bataille à Lascaux, le dernier livre, occupe une place particulièrement féconde et inspirante. Version POD : https://www.i6doc.com/fr/book/?gcoi=28001100898950
Agir au futur. Attitudes d'attente et actions expectatives
Les Dossiers du Grihl, 2017-01 | 2017, URL : https://dossiersgrihl.revues.org/6515
De quelle manière le futur fait-il partie de la réalité historique ? L'attente représente une possibilité majeure de présence du futur ; elle peut être comprise comme une réflexion sur l’avenir qui est toujours liée au passé sous la forme de l’expérience. Dans ce dossier, nous avons choisi d'analyser des actions expectatives : des actes d'attente. Les deux colloques à l’origine de ce dossier ont été organisés autour de deux sujets – la temporalité et la guerre comme événement complexe – liés par le choix d’un type d’action : l’écriture. Les contributions sont des études de cas qui ne sont pas regardées comme représentatives du régime d’historicité de la France des XVIe et XVIIe siècles. Elles aident à mieux appréhender les conditions qui permettent d’agir, entre expérience et attente, et à saisir la multi-temporalité de toute action écrite.
Albert Schirrmeister : Agir au futur - l’attente en mouvement. Introduction
Matthieu Gellard : Négocier avec acharnement. Catherine de Médicis à la veille des guerres civiles
David El Kenz : « L’avant-guerre » des guerres de Religion, d’après les lettres historiques d’Etienne Pasquier
Tatiana Debbagi Baranova : Préparer la guerre dans l’incertitude : Le cas de la Déclaration du Roy de Navarre contre les calomnies publiées es protestation de ceux de la Ligue (1585)
Bernd Klesmann : La Trompette de la Valtoline(1623) : écrire l’attente à la veille de la guerre franco-espagnole
Dinah Ribard : Guerre et chansons
Marion Brétéché : De la mort de Charles II à la guerre de Succession d’Espagne : l’horizon de la guerre et son pronostic dans la presse francophone
Nicolas Schapira : Expérience politique, livre et trajectoire sociale au XVIe siècle : Etienne du Tronchet et ses Lettres missives et familières
Christian Jouhaud : Actions expectatives de l’écrit : « Mémoires » d’un valet de chambre du roi
Albert Schirrmeister : La Grande guerre qui n’a pas eu lieu – agir au futur dans l’historiographie
Sven Externbrink : La fin d’une longue attente. Le 16 Novembre 1700 dans les Mémoires du duc de Saint-Simon
GRIHL Dialogue entre Français et japonais autour de l'usage de la littérature
(en japonais)
TABLE DES MATIÈRES
Première Partie : Usages de la littérature. Articles choisis du GRIHL
1. « Expérience de lecture et expérience sociale dans la France du premier XIXe siècle. Un retour sur les usages historiens de la littérature », Judith LYON-CAEN
2. « Histoire littéraire et Histoire de la littérature », Judith LYON·CAEN
3. « Le pays du temps », Judith LYON·CAEN
4 « Le travail de l'expérience : biographie de philosophes. Styles de vie philosophique et vie humaine à l'epoque moderne », Dinah RIBARD
5. « Le monde dans le livre. Le livre dans le monde : au-delà du paratexte. Sur le privilège de librairie au XVIIe siècle », Nicolas SCHAPIRA
6. « Les histoires d'un secrétaire d'État. Loménie de Brienne (1636-1698), un écrivain au conseil secret », Nicolas SCHAPIRA
Deuxième Partie : Littérature et témoignage
1. « Écritures de la misère au XVIIe siècle : littérature et témoignage », Christian JOUHAUD
2. « Deux lectures du Carème du Louvre de Bossuet », Yuka MOCHIZUKI
3. « Autour de la notion de "baroque". Enjeux polémiques, enjeux politiques », Christian JOUHAUD
Troisième Partie : De l'histoire du livre à l'histoire par le livre
Introduction par Hiroyuki AKAHATA
1. « Histoire par le livre : proposition de méthode », Dinah RIBARD et Nicolas SCHAPIRA
2. « Mémoires de Charles de Grimaldi : du témoignage de la Fronde au monument de la famille », Hiroaki SHIMANAKA
3. « La vérité de la littérature imaginaires sociaux, expériences de lecture, savoirs littéraires », Judith LYON-CAEN
4. « La crise de vers n'aura pas lieu : Parnassiens et Symbolistes », Hiroyuki NAKAHATA
Quatrième Partie: Littérature, témoignage. représentation de la vie
Introduction par Atsuo MORIMOTO
1. « Politique et littérature au village. Retif de la Bretonne », Dinah RIBARD et Nicolas SCHAPIRA
2. « Peuple (ou Paysan) comme concept politique » Shojiro KUWASE
3 « Suites françaises : de Rétif à Némirovsky. La France au village » Judith LYON-CAEN et Christian JOUHAUD
Témoignage d'une passion Hiroyuki NAKAHATA
Ecrire les écritures. Hommage à Daniel Fabre
La disparition brutale de Daniel Fabre en janvier 2016 laisse inachevée une œuvre dont on commence à peine à mesurer l’ampleur et la portée. Les 15 et 16 septembre 2016, un colloque d’hommage s’est tenu à l’EHESS. Cette rencontre, intitulée « écrire les écritures », a été organisée à l’initiative du Centre de Recherches Historiques. Elle a porté le regard sur le travail si fécond de l’anthropologue à propos de l’écrit en général et, en particulier, sur les pratiques d’écriture qu’on peut désigner comme littéraires.
Sommaire
Christian Jouhaud : Avant-propos
Roger Chartier : Daniel Fabre et le messager des âmes
Jean-Louis Fabiani : écrire au jour le jour
Alain Boureau : L’écriture comme prisme. Contraintes et créations des scribes médiévaux
Dinah Ribard : La voie des écrits
Philippe Artières : Fouiller l’écrit. Témoignage
Catherine Velay-Vallantin : Daniel Fabre et le conte : « Ecriture d’une différence »
Nicolas Adell : Devant la littérature
Judith Lyon-Caen : Les « savoirs romantiques » de Daniel Fabre
Jean-Claude Schmitt : L'autobiographie comme récit de conversion
Marie Scarpa : Littérature, anthropologie, ethnocritique
Pierre Antoine Fabre : Daniel Fabre à Lascaux : découverte et interprétation, écritures d’un récit et écritures d’un discours
Christian Jouhaud : Le détour par soi
Ecriture et Action, XVIIe-XIXe siècle, une enquête collective
Prix : 26 €
Les écrits agissent. Ils prescrivent, ils commentent, ils émeuvent, bref ils transmettent. Regarder cette transmission non plus sous l'angle des effets qu'elle postule mais de l'action qu'elle accomplit déplace l'histoire des écrits comme celle des actions. Entre Renaissance et XIXe siècle, ce livre s'emploie à réaliser un tel déplacement du regard. Observer, dans des situations banales ou non, ce qui peut être fait par des écrits insère le geste d'écriture dans un tissu d'autres actions qu'il modifie et qui l'infléchissent. Ces contextualisations permettent de sortir du face à face réducteur entre réceptions du lecteur et intentions d'auteur.
L'introduction, en forme de manifeste, situe la démarche par rapport aux savoirs et aux méthodes des études littéraires et des sciences sociales. L'analyse se déploie ensuite à partir de nombreux cas rassemblés autour de problèmes centraux pour la compréhension de l'écriture comme action.
Issu d'une enquête collective du Groupe de recherches interdisciplinaires sur l'histoire du littéraire (Grihl), ce travail collectif, tissé à vingt-huit, ne propose pas une improbable histoire des actions d'écriture, mais esquisse un modèle de compréhension de l'action de l'écrit et par l'écrit : une réflexion, donc, sur l'action des écrits dans l'histoire.
Le livre est introduit par Alain Cantillon, Laurence Giavarini, Dinah Ribard et Nicolas Schapira
Sommaire
Alain Cantillon, Laurence Giavarini, Dinah Ribard et Nicolas Schapira
Introduction
Mathilde Bombart, Guy Catusse, Jean-Pierre Cavaillé, Sophie Houdard et Dinah Ribard
Enfermement
Tommaso Campanella, ou l’écriture comme action à l’intérieur et à l’extérieur de la prison
Mlle Bonafon : subir et aménager le système de domination
Charles Dassoucy : exploiter les traces des épreuves passées
Mettre en action l’enfermement. La Solitaire des rochers
Epilogue en guise de conclusion
Marion Brétéché, Filippo de Vivo, Héloïse Hermant, Christian Jouhaud et Eléonore Serdeczny
Dans l’événement
Des écrits à la place de l’événement : l’interdit de Venise (1606-1607)
L’écriture dans l’événement : la marche sur Madrid de don Juan d’Autriche (1668-1631)
Quand commence l’interprétation de l’événement ? La journée des Dupes (1630-1631)
Être dans l’événement. Le journalisme politique à la fin du XVIIe siècle
Quand l’écrit s’interpose : l’événement escamoté (1649)
Christophe Blanquie, Jean-Pierre Cavaillé, Laurence Giavarini, Dinah Ribard, Nicolas Schapira et Myriam Tsimbidy
Retz. Théorie de l’action et action d’écriture
Les Mémoires de Retz à l’épreuve de La conjuration du comte Jean-Louis de Fiesque de Paul de Gondi
Les lettres épiscopales
Le conclave de 1655. écritures de Retz, écritures sur Retz
Alain Brunn, Julien Goeury, Sylvaine Guyot, Cinthia Méli et Alain Viala
Scènes(s). écriture, paroles et action
L’écrit n’agit pas comme la parole : le cas du Sermon sur l’unité de l’église de Bossuet
Action orale, action écrite : le sermon comme « agent double »
La lettre sur scène au XVIIe siècle : écriture dramatique et action épistolaire
Alain Cantillon, Stéphanie Loncle, Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard
Au XIXe siècle, l’engagement ?
L’écrit girouette : Etienne de Jouy et la série des Hermites
Les ouvriers de l’engagement
Ecrits d’Icarie
1848 et le monde des théâtres
Cinthia Méli, Oded Rabinovitch, Dinah Ribard, Marine Roussillon, Nicolas Schapira et Alain Viala
écrits de Versailles
Versailles, 1664 : les Plaisirs de l’Île enchantée
Les Versailles des Perrault
Pasteurs et brebis de cour
Alain Cantillon, Anna Keszeg, Yasushi Noro, Bérangère Parmentier, Nicolas Schapira et Xenia Von Tippelskirch
Obéissances
Relations sociales de dépendance
Protestations d’obéissance
Affaires d’obéissance
Christian Jouhaud
Pour finir
ISBN : 978-2-7132-2535-2
La Bibliothèque française (1667)
Prix : 130€
La Bibliothèque française de Charles Sorel n’est jamais tombée dans l’oubli, mais n’a jamais été vraiment lue. Cette oeuvre se présentait comme un catalogue des livres français disponibles à la date de sa parution (1664-1667) : elle a été utilisée ainsi. Aujourd’hui chercheurs et étudiants y glanent des titres et des noms d’auteurs, en consultent les notices et les corpus spécifiques composés à l’usage d’un public que l’auteur espérait nombreux et varié. Mais ce « Livre qui parle des Livres » ouvre d’autres perspectives passionnantes. Archive pour l’histoire de l’édition, il présente un état des lieux de la librairie française au milieu du XVIIe siècle. Il marque l’histoire de la lecture d’une empreinte décisive par l’attention que porte son auteur à l’information et à la formation du lecteur. Il participe à l’effervescence critique du temps, et collabore activement à la construction d’une histoire littéraire de la France que poursuivront méthodiquement les XVIIIe et XIXe siècles. Il offre un aperçu important sur la manière dont Sorel a construit son parcours d’auteur de livre en livre. Il témoigne enfin, grâce à la curiosité inlassable de Sorel pour les faits littéraires, de la diversité des formes de savoir, des courants de pensée, et des « genres d’écrire » explorés en cette période féconde de l’histoire des « belles-lettres », que l’on aurait tort de réduire au classicisme. Cette édition critique est la première ; elle accompagne le texte d’une série de dossiers mettant en lumière et en perspective ses principaux enjeux afin de permettre de le lire enfin pour lui-même.
ISBN : 9782745323910
Dissidences Jalons dans l’œuvre de Lezsek Kolakowski (1927-2009)
On ne peut pas tout réduire à des stratégies. Pratiques d’écriture et trajectoires sociales
On parle beaucoup de stratégies aujourd’hui, à tout propos. Dans le domaine des humanités et des sciences sociales, le recours à ce terme est intensif — et intensément critiqué. Ce livre propose à la réflexion des littéraires, des historiens et des sociologues des analyses de parcours individuels semés d’écrits, dans une grande diversité de situations sociales et d’expériences politiques. Comment donner toute leur place aux écrits – comment les ouvrir pleinement à l’interprétation – dans les trajectoires de leurs auteurs ? Comment faire droit à leur spécificité d’écrits tout en tenant compte de la manière dont ils s’entrelacent à l’expérience sociale ? Des écrivains de profession, mais aussi un petit noble et un prince, des juristes et des missionnaires, des soldats de la Révolution et des illuminés : les cas présentés ici montrent qu’une étude des textes qui garde en perspective leur insertion dans l’action épaissit plutôt qu’elle n’appauvrit ce qu’écrire a pu vouloir dire – et veut dire. Se trouve ainsi versée au débat sur les modèles de compréhension de l’action des individus la question de l’écriture : la question d’une action étalée dans le temps, qui laisse après elle des objets détachés du corps de leur auteur et fort bavards sur eux-mêmes.
Ont collaboré à ce numéro : Pascale Girard, Jean-Luc Chappey, Dinah Ribard, Christian Jouhaud, Bérengère Parmentier, Nicolas Schapira, Héloïse Hermant, Gisèle Sapiro et Alain Viala.
Histoire et psychanalyse. A propos des Scènes indésirables de Michel Gribinski
Dossiers du Grihl
Le temps du trouble
Penser/Rêver
Automne 2011, n° 20
Ont collaboré à ce numéro : Alain Cantillon, Laurence Giavarini, Christian Jouhaud, Judith Lyon-Caen, Dinah Ribard et Nicolas Schapira.
Ecrire en prison, écrire la prison (XVIIe-XXe siècles)
Dossiers du Grihl
2011, n° 01
Masculinité et esprit fort au début de l'époque moderne
Dossiers du grihl
2010, n° 01
Politiques de l'épistolaire au XVIIe siècle. Autour du Recueil Faret
Prix : 39 euros
Le Recueil de lettres nouvelles, dit Recueil Faret, a été publié à Paris en 1627 et plusieurs fois réédité. L'ouvrage se donne comme une anthologie exemplaire des belles-lettres contemporaines. Parfois interprété comme une oeuvre de propagande à la gloire de Richelieu, le recueil constitue en fait un objet complexe dont l'examen permet une approche renouvelée des relations entre pratiques lettrées et pouvoirs politiques, entre lettre, éloquance et action dans le monde. Fruit d'un dialogue entre spécialistes d'histoire et de littérature, ce volumme d'études remet en perspective les usages et les enjeux d'une des publications les plus marquantes de l'époque, relançant par là les manières de lire et d'interpréter les oeuvres du Grand Siècle.
Ont participé à ce livre : Mathilde Bombart, Nicolas Schapira, Anastasia Iline, Mireille Beausoleil, Déborah Blocker, Jean-François Vallée, Béatrice Brottier, Bruno Forand, Dinah Ribard, Christian Jouhaud, Eric Méchoulan, Laurence Giavarini.
L'Historien et la littérature
Il existe un débat récurrent entre littérature et histoire, formulé dans les deux disciplines. Les études littéraires posent traditionnellement la question de l'inscription de l'œuvre dans des « contextes » ou une « époque » et, pour la poser, l'histoire littéraire la plus récente tente d'intégrer au plus près des textes les acquis de la recherche historique. Mais elles interrogent peu l'historicité fondamentale de la littérature comme pratique sociale et mode de qualification des écrits. Les historiens, eux, vivent la littérature sur le mode de la tentation : ils aimeraient considérer les textes comme des sources, notamment sur le monde social, mais ont souvent du mal à développer une méthodologie adaptée, prenant en compte la littérature en tant que telle et les acquis de la recherche littéraire.
Cet ouvrage, écrit par deux spécialistes d'histoire sociale du livre et des usages de l'écrit, rend compte des diverses manières de faire de l'histoire avec la littérature, s'attache à définir méthodiquement les usages de la littérature en histoire, et développe une série de terrains ouverts par l'exploration proprement historique de la littérature (l'histoire du livre et de la lecture, la littérature comme activité sociale, la littérature comme politique, la littérature et le discours social).
Pour en savoir plus : www.collectionreperes.com
Femmes, irreligion et dissidences religieuses (XIVe-XVIIIe siècles)
L'Atelier du CRH
2009, n° 02
[en ligne], http://acrh.revues.org/index1204.html
Dissidence et dissimulation
Dissent and dissimulation / Dissidenza e dissimulazione
Les Dossiers du Grihl
2009, n° 02
[En ligne], http://dossiersgrihl.revues.org/3665
Localités : localisation des écrits et production locale d'actions
Les Dossiers du Grihl
2008, n° 01
Lire Michel de Certeau - La formalité des pratiques / Michel de Certeau lesen - Dir Förmlichkeit der pratiken
Qu'est ce que lire un historien. Les textes rassemblés dans ce volume proposent une réponse collective à cette question, à partir de "La formalité des pratiques", un des articles fondamentaux de Michel de Certeau, commenté, discuté, éprouvé ici, bien au-delà d'une simple mise au point historiographique. C'est du coeur d'une écriture, scrutée dans son exigence propre, qu'on a choisi de faire vivre des analyses qui examinent une transition majeure dans l'histoire de l'Europe moderne, "d'une organisation religieuse à une éthique politique et économique", entre politisation des comportements et métaphores du croire.
Se prêtant à une confrontation entre deux traditions étrangères l'une à l'autre, celle de l'histoire religieuse à la fraçaise et celle du débat allemand sur la portée et les limites de la sécularisation, l'écriture et la pensée de Michel de Certeau sont ici sollicitées pour leur capacité à se poser en critiques de la construction des objets et, plus généralement, des "raisons" des pratiques historiennes. Les contributions de ce volume, qui contient la première traduction allemande de "La formalité des pratiques", entendent réfléchir avec Certeau, vingt ans après sa disparition, à la question de la rupture, non seulemen dans l'histoire renouvelée des "pratiques religieuses", mais aussi dans une histoire plus large des pratiques sociales, politiques, culturelles, entre XVIe et XIXe siècle.
Le Mercure François
Mise en ligne du facsimile des 24 volumes (1605-1643) conservés dans le Fonds ancien de la Bibliothèque de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées à Marne-la-Vallée.
Histoire du livre, histoire par le livre (XVIe-XXe siècle)
Revue de synthèse
Face à la spécialisation accrue de l'histoire du livre, voire son repli sur l'érudition, à l'encontre de résistances suscitées par l'ambition de rendre raison, dans un même mouvement, de l'ensemble du travail intellectuel et de des processus matériels de la production des biens culturels, il s'agit ici de saisir ce que font les livres du monde, et dans le monde.
Ecriture et prison au début de l'âge moderne
Les Cahiers du CRH
Cette enquête coordonnée par Jean-Pierre Cavaillé est consacrée aux écritures en situations d'incarcération sous l'Ancien régime. Elle a donné lieu à une publication (n°39 des Cahiers du CRH) avec des textes de Jacques Berchtold, Mathilde Bombart, Guy Catusse, Jean-Pierre Cavaillé, Sophie Houdard, Christian Jouhaud, Michèle Rosellini et Cécile Soudan.
[En ligne], http://ccrh.revues.org/3345
Lectures à clés
Littératures classiques
Printemps 2005, n° 54
Ce numéro 54 de la revue Littératures classiques, mis en œuvre par Mathilde Bombart et Marc Escola rassemble des études centrées sur cette pratique très répandue et pourtant peu reconnue qu'est la lecture à clé. à partir de différents cas recouvrant des genres d'écrits très divers (de la pastorale à la polémique en passant par la satire), du XVIe au XIXe siècle, ces études s'intéressent aussi bien la manière dont les clés sont produites et diffusées, qu'à leurs effets dans la réception et l'interprétation des oeuvres, souvent mesurables aux multiples polémiques et débats qui, jusqu'aujourd'hui encore, ont pu entourer leur usage. Le volume regroupe une vingtaine d'études selon un parcours en cinq étapes : M. BOMBART et M. ESCOLA, Clés et usages de clés : pour servir à l'histoire et à la théorie d'une pratique de lecture I) AVATARS DE LA LECTURE ALLÉGORIQUE - Françoise LAVOCAT, Lectures à clefs de l' Arcadia de Sannazar et de L' Astrée d'Honoré d'Urfé. Allégorie et fiction dans le roman pastoral - Christophe ANGEBAULT, Théologie des clés et censure du public : lecture d'une mazarinade à clé du Sieur de Sandricourt intitulée Le Censeur du temps et du monde, portant en main la clef promise - Agnès GUIDERDONI-BRUSLÉ, Clavis mystica : de l'exégèse chrétienne à l'allégorie dans les Délices de l'esprit de Desmarets de Saint-Sorlin (1658) - Christine NOILLE-CLAUZADE, La Bruyère critique de ses critiques : les lectures à clefs ou l'invention du sens littéral. II) SATIRES, LEURRE ET DISSIMULATION - André TOURNON, Fausses clés, fausses serrures : indices et leurres chez Béroalde de Verville. Martial MARTIN, Satyres ménippées et satyrica : de la satire narrative au roman à clés (1580-1630). - Gilles BANDERIER, Un faux roman à clé : le Roman de la Cour de Bruxelles de Puget de la Serre - Myriam MAÎTRE, « Aux plus malins critiques » : La Précieusede Michel de Pure, ou le mystère des clefs - Anna ARZOUMANOV, L'Histoire amoureuse des Gaules. Entre chronique scandaleuse et divertissement galant - Volker SCHRÖDER, D'Ariste à Z… : sur quelques clés de Boileau - Alexis LÉVRIER, Comment piquer « la maligne curiosité des lecteurs » : la question des lectures à clés dans les deux premiers Spectateurs francophones III) DU COMMENTAIRE À LA RÉÉCRITURE Éric TOURRETTE, L'argument onomastique dans la Clé de 1697 des Caractères Françoise GEVREY, Lectures à clé de la Princessede Clèves au XVIIIe siècle IV) CLÉS, AUTORITÉ ET AUCTORIALITÉ - Laurence GIAVARINI, Quel homme de lettres fut Torquato Tasso à la cour de Ferrare ? Sur les enjeux des clés poétiques de l'Aminta (1573) - Alain CANTILLON, Qu'importe qui parle, de qui, et à qui dans Les Provinciales ? - Muriel BOURGEOIS, Pascal et Salomon de Tultie. Histoire de clé et de lecture V) PERSPECTIVES HISTORIOGRAPHIQUES - René GODENNE, Pour une seconde remise en cause des clés supposées des romans de Mademoiselle de Scudéry - Dinah RIBARD, Politique de la littérature : les romans à clef du XVIIe siècle selon Victor Cousin - Delphine DENIS, Chercheurs de clés : le discours des bibliographes au XIXe siècle - DOCUMENT : Fernand DRUJON, Préface de Les Livres à Clef. Étude de bibliographie critique et analytique pour servir à l'histoire littéraire (1888)
Lectures croisées du Gascon extravagant
Les Dossiers du Grihl
2007, n° 01
http://dossiersgrihl.revues.org/325
Actes de la table ronde coordonnée par Laurence Giavarini et Jean-Pierre Cavaillé, en marge du séminaire CRH-Grihl "Secret et tromperie à l'époque moderne", organisée à Paris, à l'EHESS, le 13 juin 2005.
Successivement attribué à Louis Moreau du Bail et à Onésime de Claireville, ce roman comique, paru sans nom d'auteur en 1637, reste très mal connu de la critique(1).
Par un matin de printemps, qui n'est pas sans évoquer d'entrée de jeu La Première Journée de Théophile, le narrateur ne sait où donner de la tête : une jeune femme, « tout éperdue », écume et pousse des « hurlements épouvantables » ; un cavalier ridicule, dans un gascon impeccable, joue le rôle du capitan de comédie et fait mille extravagances ; un vieil « ermite » entreprend d'exorciser la « fille » qu'il déclare possédée, sous les sarcasmes du gascon, qui n'y voit que « fadaises ». Mieux, cet extravagant raisonnable invite le narrateur, tout plein de perplexité, à ne « point [se] laisser persuader par la rhétorique de l'ermite », car, ajoute-t-il, « jamais nous ne devons appuyer de jugement que dans une infaillible connaissance de la chose qu'on propose ».
1637 est l'année de la parution du Discours de la méthode, et sans aucun doute cette phrase pourrait en être tirée. La préface avertit que le livre se propose de « joindre l'utile au délectable ». S'il se nomme Gascon , c'est « pour se moquer de tous ceux qui se mêlent de contrefaire les Gascons ».
Plus, cet extravagant est en fait « philosophe moral », et l'auteur a voulu lui donner « avantage de parler librement de tout, pour ce qu'on dit que tout est permis aux fous » : « L'homme le plus arrogant, renchérit un poème liminaire,/ Confesse franchement qu'en matière de feintes/ Il est sage parfait qui fait l'extravagant ».
Même si, à plusieurs reprises, le narrateur fait lui-même semblant de se rendre aux raisons de l'ermite, qui prêche régulièrement contre le « libertinage » de ce vrai faux extravagant, la « franchise » ou « liberté » de parole est dans ce texte, proprement programmatique. Elle touche d'abord, par la bouche du gascon, à cette question brûlante de religion, qui court tout au long du livre : la croyance en la possession, aux visions, aux exorcismes… en ces années où le bûcher d'Urbain Grandier fume encore. Mais elle investit tout autant, au fil de la narration de ses « aventures » par le gascon, l'ensemble du monde social que permet de traverser la fiction picaresque de l'escroc positif : jeunes bourgeois fats et prétentieux, prévôts, sergents et gardiens de prison corrompus, curés entremetteur ou pouilleux, un fermier général inique et son sous-fermier qui ne vaut guère mieux… la liberté satirique règle à chacun son compte, avec amusement mais sans méchanceté, et l'une des particularités du récit est du reste le renversement toujours possible du jugement éthique, son instabilité ; ainsi, lorsque un exemple de perfidie féminine consommée se retourne tout à coup en une apologie inconditionnelle des femmes. C'est d'une manière similaire que sont renversés les préjugés convenus sur les protestants ou sur les gascons, rétablis dans leur dignité bafouée…
Ce jeu critique sur la doxa , associé à la satire morale, est inséparable d'un travail sur les registres de langues et les genres du discours, exploités et parodiés, tournés en ridicule, mais aussi susceptibles d'être utilisés par le personnage du gascon pour faire montre de son savoir et de son bel esprit : poésie amoureuse, nouvelle galante, parler Phoebus, galimatias scolastique, rodomontades gasconnes, entretien pointu, etc.
Il y aussi le prêche apologétique du curé, la vision allégorique de la possédée, le latin de cuisine du prêtre crotté, etc. De sorte que le texte paraît composé pour une part importante de pièces rapportées qui forment un ensemble linguistique délibérément hétérogène, pluriel et chamarré… La liberté de parole et le jeu avec les registres de langue dessinent en filigrane une esthétique de la satire (aux deux sens de la critique des mœurs et de la pluralité des styles et des objets) et une éthique de la « franchise » (qui n'exclue certes pas feinte et dissimulation), autorisée par l' « extravagance », où se retrouve l'essentiel de la tradition du roman comique depuis le Francion . Ces deux niveaux - l'esthétique et l'éthique de « l'extravagance » (feinte) - méritent d'être pris en compte simultanément, car il existe sans aucun doute un lien fort entre la satire des mœurs (on ne peut moins rigoriste) et la critique rationaliste des croyances superstitieuses, la saturation parodique des styles de discours et la description foisonnante de certains aspects de la civilisation matérielle (vêtements, intérieur d'une prison, etc.).
C'est en fait cette hypothèse de « l'extravagance », comme moteur « comique » et « satirique » permettant le développement cohérent de ces dimensions apparemment hétérogènes du texte que nous souhaitons mettre à l'épreuve de la discussion à l'occasion de cette table ronde, et que nous proposons plus particulièrement à l'attention des intervenants. D'où les trois perspectives de travail suivantes, qui doivent être comprises comme des sollicitations et peuvent chacune donner lieu à deux interventions conçues de manière complémentaire ou contradictoire, par « binôme » - de manière à organiser trois moments de discussion :
• le ou les rapports que l'on peut établir entre satire (critique) et satura (compilation de formes et de styles).
• l'articulation monde social / monde moral envisagée à partir des questions d'énonciation et de point de vue.
• le jeu des feintes, superstitions, fictions - tout ce qui mobilise le discours de la croyance.
Les interventions ne devront pas « extravaguer » au-delà de 20 à 30 mn, pour laisser le plus de place possible à la discussion.
Intervenants : Amélie Blanckaert, Guy Catusse, Jean-Pierre Cavaillé, Filippo D'Angelo, Laurence Giavarini, Sophie Houdard et Michèle Rossellini
(1) On trouvera une bibliographie dans l'unique édition moderne établie par Felicita Robello, Pubblicazioni dell'Istituto di Lingue e letterature straniere moderne, Università di Genova, Piovan editore, Albano Terme, 1984, p. 10-11. Cette édition servira de base à nos discussions.
Mise à jour : 25 avril 2005
L'écriture historienne de Pierre Michon : la parole et la vision
Critique
mars 2005, n° 694
Actes de la journée d'études "Pierre Michon et l'histoire" organisée par Christian Jouhaud et Alain Viala le 20 mars 2004 à la Sorbonne.
Nouvelle allégorique ou histoire des derniers troubles arrivés au Royaume d'Eloquence (1658)
La Nouvelle allégorique raconte la guerre que se livrent deux royaumes : la princesse Rhétorique, souveraine du royaume d'éloquence, combat Galimatias, prince du pays de Pédanterie. Une bonne moitié de la Nouvelle est consacrée au récit de l'enrôlement des troupes dans chaque camp, ce qui permet au lecteur de découvrir les forces en présence. Du côté de Galimatias, on va trouver par exemple « les équivoques », « les allusions », les « hyperboles », commandées par différents auteurs du temps, Montmort, Nervèze et bien d'autres encore. La reine Rhétorique, conseillée par son principal ministre « Bon sens », fait appel à ses propres troupes : elle enrôle elle aussi des auteurs, tel Corneille, le chef des « cantons dramatiques », Madeleine de Scudéry, qui règne sur la « Pays de Tendre », Voiture et Sarazin, de la « région des vers galands ». La cavalerie vient du « Royaume Poëtique », et parmi les officiers de la reine, on trouve les rondeaux, les énigmes et les triolets. Après une bataille haute en couleur qui voit la victoire des forces de la reine, Galimatias parvient à reconstituer ses forces et à menacer de nouveau le camp de Rhétorique, miné par des dissensions. L'affaire se termine par un traité de paix, qui délimite précisément le territoire revenant à chacun des souverains, et qui définit leurs prérogatives.
Ce récit met donc en scène des écrivains, des figures de style, des livres, des genres littéraires, élevés au rang de personnages, confrontés les uns aux autres dans un canevas qui est celui d'un conflit armé. Cette hétérogénéité des éléments allégorisés - réalités textuelles (tropes, genres), objets (livres), institutions (l'Académie française, les collèges), personnages bien réels (auteurs, libraires, acteurs politiques…) - constitue l'une des spécificités de la Nouvelle allégorique.En outre la Nouvelle allégorique a la particularité de ne pas représenter, à la différence de la plupart des allégories, une image fixe, mais une narration, si bien que le procédé fonctionne en continu dans l'ensemble d'un récit complexe, et jusque dans les moindres détails de celui-ci. Véritable dynamique narrative, cette allégorie a un aspect indéniablement virtuose, mais résiste aussi du même coup à toute compréhension univoque. Et ce ne sont pas les notes marginales, omniprésentes, placées par Furetière lui-même pour élucider allusions ou mots techniques, qui en facilitent l'interprétation, car elles introduisent une strate supplémentaire de discours, et demandent au lecteur de circuler entre plusieurs niveaux de sens.
Stratégies de l'équivoque
Cahiers du Centre de Recherches Historiques
Avril 2004, n° 33
De la publication. Entre Renaissance et Lumière
Depuis la création du Grihl jusqu'à l'an 2002, l'essentiel de l'effort de recherche collective a été consacré à l'enquête sur l'histoire des processus de publication à l'époque moderne. Ce sujet a surgi comme un thème fédérateur au long des exposés et discussions menées en séminaire : comment des textes, des œuvres cherchent-ils à se publier ? à accéder à la publicité (des pratiques d'écriture à celles de la diffusion, de la légitimation et de la critique) ? à quelles conditions le rendre public pouvait-il être construit comme un objet d'analyses historiques ? que rend-on public ? comment ? pourquoi ? avec quels instruments et quelles sortes de profit ?
Après avoir débattu longuement de ces questions, une série d'études de cas a été mise au point. Quinze ont donné naissance à des textes. L'introduction méthodologique de ce livre a été discutée en commun. Les textes ont été l'objet de lectures collectives. Une réflexion a été développée sur les « récits de publication », si fréquents aux XVIe et XVIIe siècles : certains sont présents, brièvement commentés. Celui-ci s'organise autour de trois parties :
I - Opérations et expériences de publication,
II - Les objets de la publication,
III - Les espaces de publication.
Ce travail collectif, coordonné par Christian Jouhaud et Alain Viala, est paru aux éditions Fayard avec les contributions suivantes :
Alexandre Tarrête : "La publication des harangues : de l'action à l'impression"
Mathilde Bombart : "La publication épistolaire: deux recueils de lettres de Jean-Louis Guez de Balzac"
Dinah Ribard : La philosophie en recueils : les « pièces fugitives »
Michèle Virol : "Publier le conseil au prince : la Dîme Royale de Vauban"
Jean-Pierre Cavaillé : "Autopsie d'une non-publication : Louis Machon (1603-après 1672)"
Nicolas Schapira et Claire Levy-Lelouch : "Quand le privilège de librairie publie l'auteur"
Filippo de Vivo : "La publication comme enjeu polémique : joindre l'acte à la parole : Venise au XVIIe siècle"
Caroline Callard : "Publier la réputation : la folie d'un florentin"
Déborah Blocker : "Publier la gloire du « théâtre françois »"
Séverine Delahaye : "La lyre, la voix, la plume : publier la poésie dans l'Espagne du Siècle d'Or"
Stéphane Van Damme : "Publier la Ville au collège"
Myriam Maître : "Les escortes mondaines de la publication"
Claire Cazanave : "Une publication invente son public : les Entretiens sur la pluralité des Mondes de Fontenelle"
Antoine Lilti : "Public ou sociabilité ? Les théâtres de société au XVIIe siècle"
Mise à jour : Octobre 2002
Quelques "dix-septième siècle". Fabrications, usages et réemplois
Cahiers du Centre de Recherches Historiques
Avril 2002, n° 28-29
La notion de "siècle" : Enquête sur la construction historiographique et littéraire du XVIIe siècle comme grand siècle . Deux journées d'étude sur l'invention du "XVIIe siècle", depuis le début du XVIIIe jusqu'au début du XXe siècle, avaient été organisées en juin 2001. Une partie de l'enseignement du séminaire 1999-2000 avait été consacrée à ce thème.
[En ligne], http://ccrh.revues.org/812
De l'utilité de la littérature
Littérature Classiques
Automne, n° 37
Publié avec le concours de l'Université Toulouse-le-Mirail et du Centre National des Lettres, Paris, Honoré Champion.
Table des matières :
- Alain Viala : La fonctionnalité du littéraire : problèmes et perspectives
- Létitia Mouze : Discours poétique et discours politique chez Platon et Rousseau
- Stéphane Diebler : Cursus et court-circuit. Programmes et problèmes de l'enseignement de la philosophie dans l'Antiquité tardive
Anne-Pascale Pouey-Mounou : L'absolu et le libre-Plaisir dans l'Élégie à Loïs des Masures du "talentueux" Ronsart
- Alexandre Tarrête : Le stoïcisme de Guillaume du Vair, ou de l'utilité de la "philosophie par gros temps"
- Michèle Rosellini : Le miel et le venin, ou l'utilité de la littérature par la praelectio
- Déborah Blocker : Jean Chapelain et les "Lumières de Padoue" : l'héritage italien dans les débats sur l'utilité du théâtre (1585-1640)
- Mathilde Bombart : Représenter la distinction : comédie et urbanité chez Guez de Balzac
- Bérangère Parmentier : Arts de parler, arts de faire, arts de plaire. La publication des normes éthiques au XVIIe siècle
- Nicolas Schapira : Les enjeux d'une correspondance instructive : les lettres de Valentin Conrart à Lorenzo Magalotti
- Stéphane van Damme : Le collège, la cité et les livres : stratégies éducatives jésuites et culture imprimée à Lyon (1640-1730)
- Claire Levy-Lelouch : Le péritexte au service de la formation des esprits : l'exemple du Chef-d'œuvre d'un inconnu de Saint-Hyacinthe (1714)
- Florence Boulerie : La littérature pour apprendre le réel ? Ambiguïtés du statut de la littérature chez deux pédagogues des Lumières, Rousseau et la Chalotais
- Antoine Lilti : Vertus de la conversation : l'abbé Morellet et la sociabilité mondaine
- Dinah Ribard : D'Alembert et la "société des gens de lettres" : utilité et autonomie des lettres dans la polémique entre Rousseau et d'Alembert
- Viviane Prest : "Devoir de mémoire" et utilité : les Mémoires des réfugiés en Prusse
Miroirs de la raison d'Etat
Cahiers du Centre de Recherches Historiques
Avril 1998, n° 20
Histoire Littérature Témoignage. Écrire les malheurs du temps
Dans cette recherche sur « la misère du monde » à l'époque moderne, menée par Christian Jouhaud, Dinah Ribard et Nicolas Schapira, l'objectif est de tenir ensemble deux directions :
1 - présence et évidence du malheur dit par ceux qui le vivent ou le voient (c'est la question du témoignage, souvent porté par des textes, littéraires ou non, dont le but n'est pas de témoigner),
2 - effets de la stylisation ou de la mise en forme qui porte ce malheur jusqu'à ceux qui sont amenés à en rendre compte dans leur travail de compréhension du passé : où, quand, comment le malheur se trouve-t-il construit comme événement ?
 Les Actualités
Les Actualités
Archiver les cultures populaires
 Journée(s) d'étude - Mercredi 14 décembre 2022 - 09:00PrésentationJournée d’études organisée par Constance Barbaresco (EHESS/CRH) et Samia Myers (Université de Strasbourg), soutenue par le Centre (...)
Journée(s) d'étude - Mercredi 14 décembre 2022 - 09:00PrésentationJournée d’études organisée par Constance Barbaresco (EHESS/CRH) et Samia Myers (Université de Strasbourg), soutenue par le Centre (...)
1848 et la littérature
 Journée(s) d'étude - Jeudi 16 janvier 2020 - 09:00Les révolutions de 1848 ont été perçues par leurs contemporains comme des révolutions littéraires dans plus d'un sens : précipités par la littérat (...)
Journée(s) d'étude - Jeudi 16 janvier 2020 - 09:00Les révolutions de 1848 ont été perçues par leurs contemporains comme des révolutions littéraires dans plus d'un sens : précipités par la littérat (...)
Le particulier, le singulier, l’universel. Charles Sorel (1602-1674)
 Journée(s) d'étude - Mercredi 18 décembre 2019 - 09:00Ces travaux féconds et novateurs permettent de prendre la mesure d’une œuvre dont la force et la cohérence ont été incomprises ou sous évaluée (...)
Journée(s) d'étude - Mercredi 18 décembre 2019 - 09:00Ces travaux féconds et novateurs permettent de prendre la mesure d’une œuvre dont la force et la cohérence ont été incomprises ou sous évaluée (...)
GRIHL
Centre de recherches historiques
EHESS
54 Boulevard Raspail
75006 Paris
E-mail : grihl@ehess.fr